Avec ou sans catastrophe, le sens d’une vie reste ce qui se dérobe. Une magnifique subversion du genre post-apocalyptique.
x
Comment miner de l’intérieur le roman post-apocalyptique pour y constituer une forme de niche écologique littéraire résolument autre – ou plutôt, peut-être, comment détourner le centre de gravité apparent de ce genre bien particulier pour y inscrire une quête étrange, personnelle, intime et puissante ? C’est ce pari un peu fou qu’Emily St. John Mandel a ici relevé avec un rare brio, en s’appuyant en finesse et en force à la fois sur le travail de ses trois précédents romans, pourtant très éloignés du contexte d’une humanité élaguée à 99,99 % par un virus grippal foudroyant.
Tout commence et semble de plus d’une manière tourner autour de la mort sur scène d’un acteur célèbre, Arthur Leander, de crise cardiaque lors d’une représentation de Shakespeare à Toronto. Personnage presque banal malgré son immense succès public et hollywoodien, ce Canadien originaire d’une petite île de Colombie britannique apparaîtra pourtant, au fil des incises, des flashbacks et des réminiscences qu’il induit chez d’autres personnages, comme le principal ciment humain du roman, reliant le passé et l’avenir, servant de passerelle improbable et involontaire entre des gens que tout, sans doute, sépare désormais, si ce n’est le véritable objet de ce roman, la quête du sens.
Le silence retomba. Quelqu’un fit observer qu’il neigeait abondamment, et ils purent constater à travers les portes vitrées du hall que c’était vrai. Vue du bar, la neige était presque une abstraction, un film sur le mauvais temps dans une rue déserte.
« Eh bien… buvons à Arthur », dit le barman.
Dans la loge des enfants, Tanya donnait à Kirsten un presse-papiers. « Tiens, dit-elle en lui mettant l’objet dans les mains. Je vais encore essayer de joindre tes parents, et toi tu arrêtes de pleurer, et tu regardes cette jolie boule… » Et Kirsten, haletante, les yeux larmoyants, à quelques jours de fêter son huitième anniversaire, contempla l’objet en pensant que c’était le cadeau le plus beau, le plus merveilleux, le plus étrange qu’on lui ait jamais offert : une boule en verre dans laquelle était emprisonnée une nuée d’orage.
Dans le foyer, les personnes rassemblées au bar trinquèrent à Arthur et restèrent encore quelques minutes à boire avant de se séparer, chacun partant de son côté dans le tourbillon de flocons.
De tous ceux qui étaient présents ce soir-là, ce fut le barman qui survécut le plus longtemps. Il mourut trois semaines plus tard, sur la route, en quittant la ville. (…)
x
« Tu penses qu’il va se propager à l’extérieur de l’hôpital… ? » Jeevan avait des difficultés à raisonner clairement.
« Non, je sais que c’est déjà fait. Il s’agit d’une épidémie foudroyante. Si elle se répand ici, elle se répand dans toute la ville, et je n’ai jamais vu ça.
– Tu penses que je devrais…
– Je pense que tu devrais partir immédiatement. Ou si tu ne peux pas, fais au moins un stock de provisions et ne sors pas de chez toi. Je te quitte, j’ai d’autres coups de fil à donner. »
Il raccrocha. Le portier de nuit tourna une page de son journal. Si ç’avait été un autre que Hua, Jeevan ne l’aurait pas cru, mais il n’avait jamais connu un homme aussi doué pour l’euphémisme. Si Hua disait qu’il s’agissait d’une épidémie, c’est que le mot épidémie n’était pas assez fort. Jeevan fut soudain terrassé par la certitude que cette maladie décrite par son ami allait être la ligne de démarcation entre un avant et un après, un trait tiré sur sa vie.
Publié en 2013, traduit en français en 2016 chez Rivages par Gérard de Chergé, le quatrième roman d’Emily St. John Mandel, après la fuite inversée de « Dernière nuit à Montréal » (2009), le quadrille italo-américain de « On ne joue pas avec la mort » (2010) et la mosaïque de fausses coïncidences des « Variations Sebastian » (2012), construit une histoire extrêmement forte, dont la complexité ne se laisse pas apprivoiser facilement, mais dont les nombreux morceaux de bravoure, distillés avec un calme surprenant, nous guident dans la tempête de la grippe fatale, comme dans – avant – la vie morcelée de nos contemporains et – après – la vie timidement réorganisée malgré risques et écueils, en essayant justement de ne pas simplement « survivre ».
x
Les caravanes étaient d’anciens pickups aux roues en bois et en acier, aujourd’hui tirés par des attelages de chevaux. On avait retiré toutes les pièces rendues inutiles par la disparition de l’essence – moteur, système d’alimentation en carburant, tous les autres composants qu’aucun humain de moins de vingt ans n’avait jamais vus fonctionner – et on avait installé un banc sur le toit de chaque cabine pour les conducteurs. Les habitacles, dépouillés de tout ce qui ajoutait du poids inutile, étaient par ailleurs intacts, avec des portières qui fermaient et des fenêtres en verre trempé difficile à briser, parce qu’il était appréciable d’avoir un endroit relativement sûr où mettre les enfants quand la troupe traversait des territoires à risques. Les structures principales des caravanes – bâches en toile goudronnée arrimées sur des armatures – avaient été érigées sur le plateau des pickups. Les bâches des trois chariots étaient peintes en gris acier avec, sur les côtés, en lettres blanches, l’inscription LA SYMPHONIE ITINÉRANTE. (…)
Les trois caravanes de la Symphonie Itinérante sont identifiées en tant que telles, le nom inscrit en lettres blanches de chaque côté, mais la caravane de tête arbore une ligne de texte supplémentaire : Parce que survivre ne suffit pas.
Loin d’une cathédrale historique telle que le « Un cantique pour Leibowitz » de Walter Miller Jr., loin des vertiges métaphysiques potentiels du « Dernier monde » de Céline Minard, « Station Eleven » a su jouer avec une véritable habileté des motifs « classiques » de l’effondrement de l’humanité, tels qu’ils habillent, par exemple, « La route » de Cormac McCarthy (qui demeure, malgré les louanges, l’un des moins convaincants romans de son auteur), « Le facteur » de David Brin (dont la médiocrité de l’adaptation cinématographique ne doit pas faire oublier les véritables qualités) ou le « Vongozero » de Yana Vagner. Brassant le monde de Los Angeles à Singapour et de Londres à Paris, puis le concentrant avec un haut indice d’acidité dans quelques centaines de kilomètres carrés de la région américano-canadienne des Grands Lacs, « Station Eleven » transforme les errances et les (re)constructions en une fable d’abord humaine, autour du théâtre et de la musique qui sont loin ici de n’être « que de l’art », et jouent un rôle profond, peut-être pas si éloigné de celui des spectacles de marionnettes dans l’immense « Enig Marcheur » de Russell Hoban.
x
FD : Les autres villes que vous traversez sont-elles très différentes d’ici ?
KR : Celles où nous allons plus d’une fois sont assez semblables à New Petoskey. Il y en a d’autres où nous ne retournons jamais, parce qu’on sent tout de suite qu’il s’y passe des choses très déplaisantes. Les habitants ont peur, ou alors on a l’impression que certains ont de quoi manger tandis que d’autres meurent de faim, ou encore on voit des fillettes de onze ans enceintes, ce qui prouve qu’on est dans une zone de non-droit ou que la population est sous l’emprise d’une secte quelconque. Parfois, nous passons dans certaines villes qui ont un système de gouvernance parfaitement raisonnable, logique, mais quand on y retourne deux ans plus tard, elles ont sombré dans l’anarchie. Chaque ville a ses propres traditions. Ici, par exemple, vous vous intéressez au passé, vous avez une bibliothèque publique…
FD : Plus nous en saurons sur le monde d’avant, mieux nous comprendrons pourquoi il s’est effondré.
KR : Mais tout le monde le sait, ce qui s’est passé : le nouveau virus de la grippe porcine, les vols en provenance de Moscou, ces avions remplis de patients zéro…
FD : Néanmoins, je suis partisan de comprendre l’histoire.
x
Dans cette fournaise des sentiments et des pulsions, Emily St. John Mandel nous fournit une bien curieuse carte au trésor, une énigme dans les énigmes, pour plusieurs personnages, sous la forme d’une brève bande dessinée devenant progressivement mythique, après avoir été le centre secret d’une vie, bande dessinée qui donne son titre à l’ensemble du roman, et en offre sans doute certaines des clés les plus précieuses. À l’image de l’ensemble d’une écriture qui joue à rendre compte d’un air patelin des bonheurs et des horreurs, avant de crucifier la lectrice ou le lecteur par des fins de paragraphes résolument acérées et barbelées – et qui évite avec bonheur l’écueil si fréquent ailleurs du « trop d’explications », « Station Eleven » nous invite aussi à partager le songe du Docteur éponyme, cherchant désespérément à décider de sa vie – ce que la plupart des protagonistes du roman, avant la catastrophe, ne réalisent toujours que trop tard, ou presque.
Roman d’aventures sans concession, mais ayant choisi une tonalité d’ensemble radicalement inhabituelle, roman des choix volontaires et des décisions involontaires, « Station Eleven » raconte magistralement à chaque pas cette Apocalypse qui, davantage qu’une métaphore ou que l’émanation religieuse de santés psychologiques incertaines, se prépare dans la résignation que porte chacun de nous.
x
– Bon, j’adore mon job, et je ne dis pas ça parce que mon patron va lire mes commentaires – soit dit en passant, je suis persuadée qu’il n’aura aucun mal à identifier qui a dit quoi, anonymat ou pas. Mais bref, en regardant autour de moi, par moments, j’ai l’impression – ça va peut-être vous sembler bizarre -que le monde de l’entreprise est peuplé de fantômes. En fait, non, laissez-moi rectifier : mes parents sont dans le milieu universitaire, de sorte que j’ai été aux premières loges pour assister à ce spectacle d’horreur-là, et je sais que le milieu universitaire n’est pas une exception ; il serait donc peut-être plus juste de dire que l’âge adulte est peuplé de fantômes.
– Excusez-moi, mais je ne suis pas sûr de…
– Je parle de ces gens qui se sont retrouvés dans une vie au lieu d’une autre et qui en sont infiniment déçus. Vous voyez ce que je veux dire ? Ils ont fait ce qu’on attendait d’eux. Ils voudraient faire autre chose, mais c’est devenu impossible avec les gosses, les hypothèques et tout le reste, ils sont pris au piège. C’est le cas de Dan.
– Donc, selon vous, il n’aime pas son job.
– Exact, mais à mon avis, il ne s’en rend même pas compte. J’imagine que vous rencontrez tout le temps des gens comme lui. Des somnambules de haut niveau, essentiellement.
La belle chronique de Lohrkan est ici, celle d’Un papillon dans la lune est ici, celle de Justine Jordan (en anglais) dans The Guardian est ici, celle de Sigrid Nunez (également en anglais) dans The New York Times est là.
Emily St. John Mandel sera à la librairie Charybde (129 rue de Charenton 75012 Paris), de 19 h 30 à 21 h 30, le mardi 13 septembre prochain (2016).
x

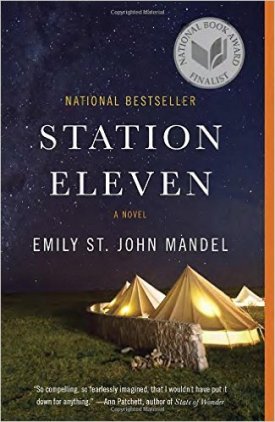






Discussion
Rétroliens/Pings
Pingback: Station eleven – Emily St. John Mandel – Service de Presse | Garoupe - 13 septembre 2016
Pingback: Un deuxième aperçu, en 20 titres, de notre septembre 2016 | Charybde 27 : le Blog - 12 octobre 2016
Pingback: Note de lecture : La moitié du fourbi – 4 : « Lieux artificiels (Revue) | «Charybde 27 : le Blog - 23 octobre 2016
Pingback: Les best-sellers 2016 de la librairie Charybde | Charybde 27 : le Blog - 9 janvier 2017
Pingback: Note de lecture : « Dans la forêt (Jean Hegland) | «Charybde 27 : le Blog - 16 janvier 2017
Pingback: Note de lecture : « American War – A Novel (Omar El Akkad) | «Charybde 27 : le Blog - 13 août 2017
Pingback: Note de lecture : « Zone 1 (Colson Whitehead) | «Charybde 27 : le Blog - 24 décembre 2017
Pingback: Note de lecture : « Brûlées (Ariadna Castellarnau) | «Charybde 27 : le Blog - 13 juin 2018
Pingback: Note de lecture : « Le poids de la neige (Christian Guay-Poliquin) | «Charybde 27 : le Blog - 16 septembre 2018
Pingback: Note de lecture : « L’hôtel de verre (Emily St. John Mandel) | «Charybde 27 : le Blog - 9 Mai 2021
Pingback: Note de lecture : « Aquariums (J.D. Kurtness) | «Charybde 27 : le Blog - 24 juillet 2022