Un trésor à propos de trésors : la puissance toujours neuve du « classique ».
x
RELECTURE

C’est en 1991, six ans après la mort d’Italo Calvino, qu’est paru ce recueil désormais illustre (« classique », presque évidemment), regroupant brefs essais et articles publiés initialement entre 1954 et 1985 dans divers supports (journaux, conférences et préfaces, principalement), tous chapeautés par l’article introductif, recueil qui figurait parmi les ouvrages sur lesquels travaillait l’auteur juste avant son décès. Traduit en français par Jean-Paul Manganaro, le recueil est d’abord paru chez nous au Seuil en 1993, avant de connaître les vicissitudes éditoriales de l’ensemble de l’œuvre d’Italo Calvino – et d’être désormais disponible chez Folio Gallimard.
Les 34 textes traitant d’auteurs et d’œuvres offrent une exceptionnelle démonstration d’acuité critique, capable de percevoir et raconter le détail comme la vue d’ensemble, en insérant chaque élément aussi bien dans une culture globale largement partageable que dans une visée plus personnelle. Chacun contribue à démontrer en détail, sans jamais se départir d’une grâce joueuse et d’une légèreté surprenante, les quatorze théorèmes mi-sérieux mi-ironiques de l’article liminaire, « Pourquoi lire les classiques », théorèmes que je reproduis ci-dessous, sans les explications hilarantes, rusées et fort convaincantes qui accompagnent chacun d’entre eux.
1. Les classiques sont ces livres dont on entend toujours dire : « Je suis en train de le relire… » et jamais : « Je suis en train de le lire… »
2. Sont dits classiques les livres qui constituent une richesse pour qui les a lus et aimés : mais la richesse n’est pas moindre pour qui se réserve le bonheur de les lire une première fois dans les conditions les plus favorables pour les goûter.
3. Les classiques sont des livres qui exercent une influence particulière aussi bien en s’imposant comme inoubliables qu’en se dissimulant dans les replis de la mémoire par assimilation à l’inconscient collectif ou individuel.
4. Toute relecture d’un classique est une découverte, comme la première lecture.
5. Toute première lecture d’un classique est en réalité une relecture.
6. Un classique est un livre qui n’a jamais fini de dire ce qu’il a à dire.
7. Les classiques sont des livres qui, quand ils nous parviennent, portent en eux la trace des lectures qui ont précédé la nôtre et traînent derrière eux la trace qu’ils ont laissée dans la ou les cultures qu’ils ont traversées (ou, plus simplement, dans le langage et les mœurs).
8. Un classique est une œuvre qui provoque sans cesse un nuage de discours critiques, dont elle se débarrasse continuellement.
9. Les classiques sont des livres que la lecture rend d’autant plus neufs, inattendus, inouïs, qu’on a cru les connaître par ouï-dire.
10. On appelle classique un livre qui, à l’instar des anciens talismans, se présente comme un équivalent de l’univers.
11. Notre classique est celui qui ne peut pas nous être indifférent et qui nous sert à nous définir nous-même par rapport à lui, éventuellement en opposition à lui.
12. Un classique est un livre qui vient avant d’autres classiques ; mais quiconque a commencé par lire les autres et lit ensuite celui-là reconnaît aussitôt la place de ce dernier dans la généalogie.
13. Est classique ce qui tend à reléguer l’actualité au rang de rumeur de fond, sans pour autant prétendre éteindre cette rumeur.
14. Est classique ce qui persiste comme rumeur de fond, là même où l’actualité qui en est la plus éloignée règne en maître.
x

Doté d’une culture phénoménale et largement tous azimuts, encyclopédiste par penchant et oulipien par goût, Italo Calvino nous régale de son érudition (ses articles à propos de Pline, de Jérôme Cardan, de Cyrano de Bergerac, de Gianmaria Ortes, d’Henry James, ou d’Eugenio Montale, proposent d’impressionnants modèles de ce genre subtil – qui parvient notamment à détecter la grandeur intemporelle dans le – relativement – moins connu ou moins célébré, de nos jours).
Mais, à y bien regarder, la menace d’une perte de la mémoire revient à plusieurs reprises dans les chants IX-XII : d’abord avec l’invitation des Lotophages, puis avec les drogues de Circé puis, encore, avec le chant des Sirènes. Chaque fois, Ulysse doit s’en garder, s’il ne veut pas tout oublier à l’instant… Oublier quoi ? La guerre de Troie ? Le siège ? Le cheval ? Non : sa maison, le cap de la navigation, le but de son voyage. L’expression qu’Homère utilise dans ces cas-là, c’est « oublier le retour ». (« Les Odyssées dans L’Odyssée », 1981)
Lorsqu’il évoque des textes réputés davantage connus (des classiques parmi les classiques au sein de notre culture contemporaine, oserait-on dire), Italo Calvino nous surprend en chaque occurrence de deux manières, au moins : en synthétisant avec une force et une concision exceptionnelles certains apports uniques de telle ou telle œuvre à l’édifice mental qui nous tient debout, d’une part, et en montrant une folle inventivité pour dégager, toujours (c’est l’un des théorèmes-clé de sa mini-théorie des classiques), des sentiers jusqu’alors quasiment inconnus, ou si rarement fréquentés, d’autre part. On se délectera ainsi sans vergogne de sa relecture d’ Homère, ou plus encore de celle des « Métamorphoses » d’Ovide, à rapprocher sans attendre de la somptueuse nouvelle traduction de Marie Cosnay publiée en 2017, de relier entre elles les composantes tardives et potentiellement proto-ironiques ou métaphysiques (bien avant Cervantès) du roman de chevalerie, à propos de « Tirant le Blanc » ou de L’Arioste, jouant à merveille avec les composantes subtilement structuralistes qu’explorait en détail, lors de la création du genre, un Jean-Jacques Vincensini (« Pensée mythique et narrations médiévales », 1996), ou encore de relier l’irruption de certains textes à un substrat scientifique, économique et idéologique, par exemple en étudiant Galilée, Daniel Defoe ou Mark Twain.
x
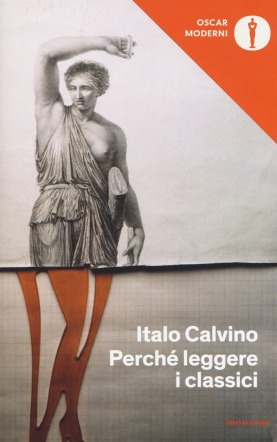
Dans le vaste échantillonnage de mythes qu’est le poème dans son entier, le mythe de Pallas et d’Arachné peut contenir à son tour deux échantillonnages à échelle réduite orientés dans des directions idéologiques opposées : l’une pour inspirer une crainte sacrée, l’autre pour inciter à l’irrévérence et au relativisme moral. Si on en inférait que tout le poème doit être lu de la première façon – étant donné que le défi d’Arachné est sévèrement puni -, ou de la seconde – étant donné que le rendu poétique favorise la coupable et victime -, on commettrait une erreur : les Métamorphoses entendent représenter l’ensemble du racontable transmis par la littérature, avec toute la force d’images et de significations que celui-ci charrie, sans décider – selon l’ambiguïté proprement mythique – entre les clefs de lecture possibles. C’est seulement en accueillant dans le poème tous les récits et toutes les intentions de récit qui courent dans toutes les directions, se pressent et se bousculent pour se canaliser dans la mesure ordonnée de ses hexamètres, que l’auteur des Métamorphoses sera certain de ne pas servir un dessein partial, mais la multiplicité vivante n’excluant aucun dieu, connu ou inconnu. (« Ovide et la contiguïté universelle », 1979)
L’autre grand miracle de ce recueil, et peut-être son plus puissant en réalité, c’est la manière dont il donne envie, de lire un auteur encore inconnu, et, au moins autant, de relire comme à neuf un auteur déjà fréquenté, même beaucoup fréquenté le cas échéant, reproduisant à l’échelle de ce conteur analytique magnifique qu’est Italo Calvino l’œuvre (presque) sacerdotale, joueuse (en tout cas) et sans fin (espérons-le) des libraires invités chez Charybde. Il en est ainsi lorsqu’il nous entretient du « Candide » de Voltaire, du « Ferragus » de Balzac, de « L’ami commun » de Dickens, des « Trois contes » de Flaubert, du « Docteur Jivago » de Boris Pasternak, ou encore de « L’affreux pastis de la rue des Merles » de Carlo Emilio Gadda. Il en est encore plus ainsi, si c’est possible, lorsqu’il revisite par des angles inattendus les capitaines de Joseph Conrad, les frères ennemis de Robert Louis Stevenson, la philosophie de Raymond Queneau, les sacrifices humains de Cesare Pavese, ou encore les miroirs et les labyrinthes de Jorge Luis Borges.
L’œil de Félicité, l’œil du hibou, l’œil de Flaubert. Nous nous rendons compte que le véritable thème de cet homme si renfermé en lui-même a été l’identification avec l’autre. Dans l’étreinte sensuelle de saint Julien au lépreux, nous pouvons reconnaître le point d’aboutissement difficile auquel tend l’ascèse de Flaubert en tant que programme de vie et de rapport avec le monde. Les Trois Contes sont peut-être le témoignage d’un des plus extraordinaires itinéraires spirituels que l’on ait jamais accomplis en dehors de toutes les religions. (« Trois contes », 1980)
x

Je me permettrai pour conclure trois mentions spéciales sur ce recueil si profondément enthousiasmant, si prometteur en secrets toujours renouvelés et toujours personnalisables.
À propos de la guerre en littérature, Italo Calvino trouve des mots extraordinaires (qui résonneront certainement avec ceux de certains libraires invités, déjà mentionnés, Xavier Boissel et Jean-Yves Jouannais, ici, de DOA, ici, d’Oliver Gallmeister, ici, et d’Aurélien Masson, ici) pour évoquer « L’Anabase » de Xénophon, « La Chartreuse de Parme » de Stendhal (avec la joie que l’on retrouvait dans la parole d’Arno Bertina à son propos, ici), « Deux hussards » de Tolstoï et plusieurs romans d’Ernest Hemingway.
Le fait d’avoir senti la guerre comme l’image la plus véridique, comme l’image normale du monde bourgeois à l’époque impérialiste, a été l’intuition fondamentale de Hemingway. À dix-huit ans, encore avant l’intervention américaine, rien que par envie de voir comment était la guerre, il réussit à rejoindre le front italien, d’abord comme chauffeur d’ambulance, ensuite comme directeur d’une « cantine », et il fait la navette à bicyclette entre les tranchées du Piave. (…) Le goût de la guerre raconté dans les courts chapitres de De nos jours fut décisif pour Hemingway, comme pour Tolstoï les impressions décrites dans les Récits de Sébastopol. Et je ne sais si ce fut l’admiration que Hemingway avait pour Tolstoï qui le poussa à chercher l’expérience de la guerre, ou si celle-ci fut à l’origine de celle-là. Certes, la manière de vivre la guerre décrite par Hemingway n’est plus celle de Tolstoï, ni celle d’un autre auteur qu’il chérissait, le petit classique américain Stephen Crane. C’est une guerre dans des pays lointains, vue avec le détachement de l’étranger : Hemingway préfigure ce que sera l’esprit du soldat américain en Europe. (« Hemingway et nous », 1954)
x

À propos de « Jacques le fataliste et son maître », de Denis Diderot, Italo Calvino construit un étonnant et puissant triangle littéraire jouant de la résonance particulière qu’entretiennent le « Don Quichotte » de Cervantès, le « Tristram Shandy » de Laurence Sterne et le roman hybride et joueur du touche-à-tout philosophe des Lumières.
La parenté entre les deux œuvres doit être cherchée à un niveau plus profond : le véritable thème de l’une comme de l’autre est l’enchaînement des causes, l’inextricable ensemble de circonstances qui déterminent le moindre événement et qui joue, pour les Modernes, le rôle de Fatum.
Dans la poétique de Diderot ce n’était pas tant l’originalité qui comptait, mais le fait plutôt que les livres se répondent, luttent entre eux, se complètent réciproquement : c’est dans l’ensemble du contenu culturel que chaque opération de l’écrivain trouve un sens. Le grand cadeau que Sterne fait non seulement à Diderot, mais à la littérature mondiale, et qui débouchera ensuite sur le courant de l’ironie romantique, est constitué par l’allure désinvolte, l’effusion d’humeurs, les acrobaties de l’écriture.
Rappelons qu’un grand modèle déclaré tant pour Sterne que pour Diderot était le chef-d’oeuvre de Cervantès. Mais l’héritage qu’ils en tirent est différent : l’un fait valoir l’heureuse maestria anglaise dans la création de personnages pleinement caractérisés par la singularité de quelques traits caricaturaux, l’autre a recours au répertoire des aventures picaresques d’auberge et de grand-route suivant la tradition du roman comique. (« Jacques le fataliste », 1984)
À propos de Francis Ponge et de son « Parti pris des choses » enfin, là où une première lecture de ma part, il y a bien des années et dans un cadre scolaire, m’avait laissé plutôt (et c’est un euphémisme) sur ma faim, les mots d’Italo Calvino, dans son article « Francis Ponge » de 1979, viennent de me donner l’envie de relire derechef le poète français, en étant prêt cette fois à y trouver les trésors qui s’étaient dérobés une première fois.
Conrad a vécu dans une période de transition du capitalisme et du colonialisme britanniques : le passage de la marine à voile à celle à vapeur. Son monde héroïque est celui de la civilisation des voiliers des petits armateurs, un monde fait de clarté rationnelle, de discipline dans le travail, de courage et de devoir opposés à l’âpreté au gain. La nouvelle marine des paquebots des grandes compagnies lui apparaît comme étant sordide et lâche, tels le capitaine et les officiers du Patna qui poussent Lord Jim à se trahir lui-même. De même, celui qui rêve encore des vertus antiques se transforme en un Don Quichotte, ou se rend, entraîné vers l’autre pôle de l’humanité conradienne : les épaves humaines, les agents commerciaux sans scrupules, les bureaucrates coloniaux « ensablés », toute la lie humaine d’Europe qui commence à se déposer dans les colonies, et que Conrad oppose aux anciens marchands-aventuriers romantiques comme son Tom Lingard. (« Les capitaines de Conrad », 1954)
x


Je me suis mise à apprendre l’italien l’an dernier pour pouvoir lire Calvino dans le texte original, et je suis en train de lire ce livre. Vraiment excellent, oui !
Publié par WordsAndPeace | 17 février 2023, 19:43