Société victorienne et palinodies adultes dans le regard d’une petite fille.
x
RELECTURE
Publié en 1896 en feuilleton et en 1897 en volume, traduit en français en 1947 par Marguerite Yourcenar chez Robert Laffont, « Ce que savait Maisie », le quatorzième roman d’Henry James, est sans doute l’un des plus célèbres de son auteur.
Le propos apparent du roman tient en quelques phrases : dans la bonne société britannique de la fin du XIXe siècle, corsetée dans la morale victorienne des apparences à sauver coûte que coûte, Beale et Ida Farange, les parents de la petite Maisie, divorcent, puis, après d’intenses batailles autour de la garde de la fillette, finalement alternée de six mois en six mois, se remarient quelque temps plus tard, l’un avec la jeune et belle première gouvernante de Maisie, miss Overmore, l’autre avec le gentil, séduisant et également jeune Sir Claude.
Le procès avait paru interminable, et certes le cas était compliqué, mais la décision du juge avait été confirmée en appel en ce qui concernait l’attribution de l’enfant. Le père, bien qu’éclaboussé des pieds à la tête, avait obtenu gain de cause, et recevait la garde de la fillette en conséquence de ce triomphe ; non que la réputation de la mère fût véritablement plus ternie que la sienne, mais l’éclat du teint féminin (et celui de la dame en question avait été fort admiré à l’audience) semblait plus endommagé par ces taches. Toutefois, une clause de ce verdict lui enlevait de sa douceur aux yeux de Beale Farange : l’intimation d’avoir à rembourser à sa femme les deux mille six cents livres sterling qu’elle avait versées trois ans plus tôt, en vue de l’entretien de l’enfant, et précisément à la condition qu’il n’engagerait pas de procès ; de cette somme, il avait eu l’administration, et ne pouvait rendre le moindre compte. Cette obligation imposée à son adversaire versait quelque baume sur le ressentiment d’Ida, émoussait tant soit peu l’aiguillon de sa défaite, et forçait visiblement Mr. Farage à baisser l’oreille. Il était bien incapable de restituer l’argent ou de trouver à le rembourser ; aussi, après un démêlé guère moins public et guère plus décent que la première bataille, Mr. Farange ne sortit d’embarras que grâce à un compromis proposé par ses conseillers légaux et finalement accepté par ceux de sa femme.
Cet arrangement le tenait quitte de sa dette, et disposait de la fillette d’une manière digne du tribunal de Salomon. Elle était coupée par moitié, et les tronçons jetés impartialement aux deux adversaires. Chaque parent l’aurait pour six mois ; elle passerait tour à tour un semestre avec chacun d’eux. Ce jugement parut bizarre à des yeux encore blessés par l’impitoyable lumière projetée sur ce père et cette mère durant le procès, où ni l’un ni l’autre n’étaient apparus le moins du monde comme un exemple à offrir à la jeunesse et à l’innocence.
x
La situation tenant lieu de base romanesque était sans doute exceptionnelle dans l’Angleterre de la fin du XIXe siècle, si elle est somme toutye fort banale de nos jours. Le tour de force, lui, est ici multiple, mais tient sans doute avant tout à l’art consommé du point de vue que développe Henry James durant ces presque 400 pages d’enfance et d’adolescence : passées les toutes premières pages d’introduction, dont un extrait figure ci-dessus, l’ensemble de la narration est entièrement confié aux yeux de la petite Maisie qui, au fil des pages, se débattra seule pour interpréter correctement les informations qu’elle reçoit et les scènes dont elle est témoin. C’est d’ailleurs grâce à David Lodge, qui – dans son captivant « L’art de la fiction » – avait fait de « Ce que savait Maisie » la cheville ouvrière de son analyse de l’art du point de vue, que j’avais découvert pour la première fois ce roman si particulier d’Henry James.
L’esprit de sa jeune amie n’avait jamais tant travaillé qu’en cette minute où elle se trouvait obligée de se demander quels avantages Mrs. Beale comptait ainsi obtenir. Durant la période de l’omelette aux rognons et du poulet sauté, Maisie hésitait encore quant à l’endurance dont Mrs. Wix allait faire preuve, cependant que la seule survivante des quatre pères et mères de Maisie bavardait aimablement avec la gouvernante. C’était étrange, mais Maisie se sentit dès cet instant aussi intéressée à l’avenir du sens moral de Mrs. Wix, que Mrs. Wix avait pu l’être au sien ; elle venait de comprendre que la bonne dame se trouvait avoir à résister cette fois à une tentation toute nouvelle. Dans les circonstances présentes, c’était bien plus difficile pour Mrs. Wix d’avoir à résister à Mrs. Beale elle-même qu’à l’image que Sir Claude présentait d’elle. Maisie sentit que les derniers événements (quelle que fût leur nature), risquaient d’avoir des conséquences bien plus grandes qu’elle ne s’y était attendue.
x
x
« Ce que savait Maisie » est probablement, bien avant les savants traités apparus en Europe et aux États-Unis dans les années 1970 à propos de la situation psychologique des enfants de divorcés, une incursion littéraire vertigineuse dans l’égoïsme potentiel de parents bien peu soucieux, en réalité, de cette notion encore mystérieuse qu’était « l’intérêt de l’enfant », ainsi qu’une mise en exergue de la culpabilité que ces mêmes parents devraient ressentir. Le roman est aussi, d’une manière pourtant plus discrète, un hommage incertain à la formidable capacité d’absorption, pour le meilleur ou le pire, de l’enfance, là aussi bien avant que ne lui soit appliquée, à partir des vulgarisations de John Bowlby et de Boris Cyrulnik, le concept de résilience.
Grâce à ce fort sentiment de l’immédiat, qui constitue la vraie atmosphère de l’âme enfantine, le passé, dans chaque alternative, devenait pour elle aussi vague que l’avenir ; elle s’abandonnait tout entière à l’actualité avec une bonne foi qui aurait dû toucher le père comme la mère. Si cruels qu’eussent été leurs calculs, ils furent d’abord justifiés par l’événement : elle était bien le petit volant empenné qu’ils pouvaient sauvagement se lancer l’un à l’autre. Tout le mal qu’ils étaient capables de penser, ou de prétendre penser l’un de l’autre, ils le versaient dans sa petite âme gravement attentive comme dans un réceptacle sans fond, et chacun d’eux se croyait sans doute obligé en toute conscience à l’instruire de la triste vérité, pour la sauvegarder de l’influence de l’autre. Elle était à l’âge où toutes les histoires sont vraies, et où toutes les idées sont des histoires. L’actuel était absolu, le présent seul existait.
x
Par ailleurs, si la critiquelittéraire a vu pendant plusieurs dizaines d’années en « Ce que savait Maisie » une charge plus ou moins voilée, de la part d’Henry James, contre un certain relâchement du sens moral (le mot lui-même est central dans le dernier tiers du roman, en effet), il est au moins aussi tentant, en une lecture plus contemporaine, d’y discerner les abîmes plus ou moins secrets de la société victorienne (dominant tout de même largement alors la vie occidentale), et le vertige qu’y induit chez tout un chacun et toute une chacune le fait que la vie y soit inexorablement réglée par (dans cet ordre) l’argent et les convenances, dans une atmosphère tacite de peur omniprésente, chez toutes et tous, de tomber, de déchoir, et de faillir à son rang, avec toutes les conséquences psychologiques et comportementales que cela peut entraîner chez les individus – et dans les relations qu’ils entretiennent entre eux.
Comment un tel homme pouvait-il trembler si souvent ? Elle comprenait enfin qu’il existait une chose qu’un homme comme lui pouvait craindre par-dessus tout : il pouvait avoir peur de lui-même. Quoi qu’il en soit, il avait peur en ce moment, et cette peur regorgeait pour elle de douleur, de beauté, de détresse ; cette peur se servait de café et de tartines, parlait et riait, mais ses paroles et ses rires ne trompaient pas Maisie. La peur était dans sa voix moqueuse, traînante et fausse, dans cette façon qu’il avait eue de l’emmener au café pour imiter leurs anciens passe-temps de Londres, pour imiter en somme un état de choses qui entre eux avait complètement changé, et qu’elle avait vu changer sous ses propres yeux, quand, la veille dans le salon, Mrs. Beale s’était soudain dressée devant elle. Mrs. Beale continuait d’ailleurs de se dresser devant elle, en ce moment, et avant que leur café ne fût servi, l’enfant en était venue à poser sans détours la question que les quelques mots qu’il avait proférés en arrivant lui permettaient de risquer :
– Est-ce que nous allons déjeuner à midi avec Mrs. Beale ?
Notons que cet indiscutable chef d’œuvre littéraire n’a engendré que fort tardivement des adaptations cinématographiques, celle d’Édouard Molinaro en 1995 et celle de Scott McGehee et David Siegel en 2012.
x


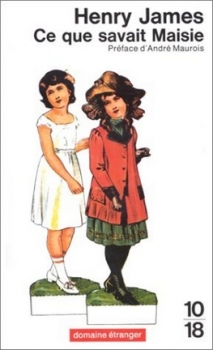



Discussion
Rétroliens/Pings
Pingback: Note de lecture : « Pourquoi lire les classiques (Italo Calvino) | «Charybde 27 : le Blog - 7 août 2018
Pingback: Note de lecture : « La folie de ma mère (Isabelle Flaten) | «Charybde 27 : le Blog - 5 juin 2022