Lorsque l’un des créateurs de la micro-histoire explore la notion de distance sous tous ses angles ou presque : puissant et stimulant.
x
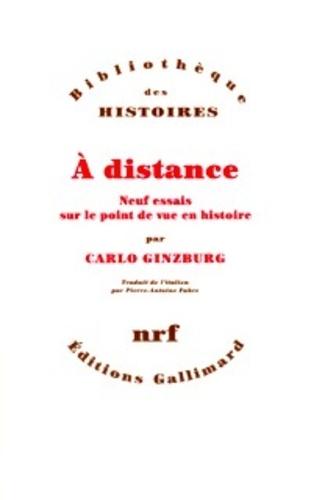
La lectrice ou le lecteur de « Mythes, emblèmes, traces » (1986), recueil d’articles dans lequel on trouve notamment le texte fondamental de 1979, pour l’approche indicielle en histoire, tout particulièrement, qu’est « Traces – Racines d’un paradigme indiciaire », sera peut-être d’accord avec moi pour juger que, toutes proportions gardées, c’est sans doute dans ses textes courts et incisifs, davantage encore que dans ses « gros » travaux pourtant passionnants tels que « Les batailles nocturnes » (1966), « Le fromage et les vers » (1976) ou « Le sabbat des sorcières » (1989), que Carlo Ginzburg nous offre les meilleurs exemples de sa singulière capacité de création par le rapprochement imaginatif dans le domaine scientifique qui est le sien, celui de l’histoire – au sein duquel il est généralement considéré comme l’un des fondateurs du courant dit « micro-historique ».
Dans cette même direction globale, « À distance – Neuf essais sur le point de vue en histoire », publié en 1998, traduit en français en 2001 par Pierre-Antoine Fabre dans la Bibliothèque des Histoires de Gallimard, impressionnera peut-être encore davantage que le recueil déjà essentiel qui le précédait de douze ans.
Si le titre français du recueil insiste sur la notion de point de vue, tout à fait pertinente, le titre italien est néanmoins plus ouvert, et s’attache avant tout à la notion de distance – dont le point de vue ne serait alors, en lui-même qu’un cas particulier ou un avatar local, et c’est certainement ainsi que s’interprète au mieux le septième essai (« Distance et perspective – Deux métaphores »), qui explicite en passant le pari théorique de l’ensemble de ses huit compagnons de route, comme on le verra brièvement ci-dessous.
Le premier essai (« L’estrangement – Préhistoire d’un procédé littéraire ») illustre d’emblée avec une grande force le principe d’hybridation créative qui irrigue le travail de l’auteur : à partir d’une réflexion littéraire du proto-formaliste russe Viktor Chklovski, et de « l’idée selon laquelle l’art serait un instrument pour raviver notre perception figée par l’habitude » – on pensera certainement au passage au travail philosophique sur l’innovation artistique conduit par Boris Groys (« Du nouveau », 1992) -, à partir de la présence de Marc Aurèle chez Tolstoï, à partir de l’usage, chez Montaigne ou chez d’autres, de figures narratives du type « Paysan du Danube » ou assimilables, Carlo Ginzburg fait davantage qu’esquisser une analyse du jeu technique littéraire avec le regard du « sauvage intérieur », et caractérise déjà un estrangement du XIXe siècle à la Tolstoï et un estrangement du XXe siècle à la Proust. Cet article résonne d’ailleurs inévitablement de manière profonde avec le travail fondamental de Darko Suvin en matière de science-fiction (« Metamorphoses of science fiction », 1979),
Les devinettes sont un phénomène présent dans les cultures les plus différentes, dans toute culture peut-être. L’hypothèse selon laquelle Marc Aurèle se serait inspiré du genre populaire des devinettes s’accorderait bien avec une idée qui m’est chère, celle d’un rapport circulaire entre culture savante et culture populaire, une circularité qui ressort aussi – cela, je crois, n’a jamais été noté – du destin posthume des réflexions de Marc Aurèle. Ce dernier point demande une digression particulière, qui fera voir comment Tolstoï avait lu Marc Aurèle. Cette lecture renforça des positions qui étaient déjà devenues celles de Tolstoï dans une phase antérieure de son développement intellectuel et moral : d’où l’écho profond qu’elle trouva en lui.
x

Le deuxième essai (« Mythe – Distance et mensonge ») représente sans doute l’un des meilleurs exemples de la manière dont Carlo Ginzburg peut reprendre un débat théorique déjà ancien (ici, celui du statut réel du mythe en Grèce ancienne, débat où s’illustrèrent par exemple Marcel Détienne ou Paul Veyne au tournant des années 1980), y insérer différents regards obliques affûtés, et en tirer un tout autre matériau que celui auquel on se serait trop vite attendu.
Continuité des mots n’est pas toujours continuité de leur sens. Ce que nous appelons philosophie est encore malgré tout la philosophie des Grecs. Notre économie, qu’il s’agisse de la discipline ou de son objet, et l’économie des Grecs n’ont en revanche que peu de choses en commun. Nous parlons souvent de mythe en un sens général ou en un sens spécifique : les mythes des nouvelles générations, les mythes des peuples d’Amazonie, et nous appliquons sans hésiter le terme de mythe à des phénomènes très éloignés dans le temps comme dans l’espace. Doit-on voir là une manifestation de notre superbe ethnocentrique ?
De la position centrale – mais beaucoup plus complexe qu’il ne semble – du mythe chez Platon, en le passant d’abord au filtre de l’approche à l’époque presque révolutionnaire de Thucydide quant à l’émergence de la vérité historique, puis en examinant les transformations opérées par Boèce sur les travaux d’Aristote, Carlo Ginzburg montre la manière paradoxale dont le mythe grec irrigue la chrétienté, et contribue puissamment – même si, souvent, souterrainement – à élaborer des règles de passage entre monde fictif et monde réel (il faudra d’ailleurs que je vous parle prochainement du « Fait et fiction » de Françoise Lavocat). Et l’usage de ce substrat d’une extrême puissance dans la publicité, la propagande politique, la fabrication continue de mythes contemporains et le storytelling utilitariste, au moins depuis le XIXe siècle, en découle de manière lumineuse, illustration sans équivoque de la manière indiciaire.
Le passage d’un monde fictif au monde réel et vice versa, d’un monde fictif à un autre, ou du monde des règles à celui des métarègles, appartient certainement aux possibilités de l’espèce humaine en général. Mais c’est dans le cadre d’une culture spécifique (la nôtre) que la distinction entre ces différents registres a été théorisée avec un raffinement parfois extrême sous les impulsions successives et convergentes de la philosophie grecque, du droit romain et de la théologie chrétienne. L’élaboration de concepts tels que μῦθοϛ, fictio, signum n’est que l’un des aspects d’une tentative de manipulation du réel toujours plus efficace. Le résultat est sous nos yeux, incorporé aux objets que nous utilisons (dont l’ordinateur sur lequel j’écris ces mots). Le patrimoine technologique qui a donné aux Européens de conquérir le monde comportait aussi une capacité renforcée au cours des siècles de contrôler la relation entre visible et invisible, entre réalité et fiction.
x

Je ne m’étendrai pas, en revanche, sur les essais 3 (« Représentation – Le mot, l’idée, la chose »), 4 (« Ecce – Racines scripturaires de l’image cultuelle chrétienne »), 5 (« Idole et image – Une page d’Origène et son destin ») et 9 (« Un lapsus du pape Wojtila ») : passionnants à nouveau par ce qu’ils donnent à voir et à mesurer de la technique d’enquête et de rapprochement heuristique et significatif mise en oeuvre par Carlo Ginzburg, leurs sujets sont restés pour moi trop opaques, ou simplement moins intéressants, à titre purement personnel, que les cinq autres essais du volume – même si , dans le neuvième essai, la subtilité de l’étude du statut d’un lapsus possible, ou en tout cas d’une référence non maîtrisée, interroge avec intelligence les rapports historiques et contemporains entre chrétiens et juifs, et force une fois de plus l’admiration.
Le sixième essai (« Style – Inclusion et exclusion »), rappelant fort à propos que Carlo Ginzburg est aussi un historien d’art parfaitement reconnu, offre une étonnante généalogie comparée de la notion de style (en parlant du style d’un artiste mais pas uniquement), à partir d’un bref passage du « De oratore » de Cicéron, travaillé ensuite au corps chez Balthasar Castiglione (« Le courtisan », 1528), qui ouvre sur le traitement du curieux point aveugle Le Titien dans les célèbres « Vies des meilleurs peintres, sculpteurs et architectes » (1550) de Giorgio Vasari, et sur l’analyse qu’en fit Erwin Panofksky dans son « L’œuvre d’art et ses significations » (1955). En suivant, autour de la caractérisation de l’art gothique, la manière dont la notion de style distinctif s’impose entre le XVIIe et XIXe siècles, l’auteur nous prépare l’un de ses retournements créatifs dont il a le secret, pour travailler à nouveau le lien entre art et science, autour de la figure ambiguë de Paul Feyerabend, de certains présupposés de son « Contre la méthode » (1955) et des non-dits de son autobiographie (légèrement) posthume « Tuer le temps » (1995).
Le septième essai (« Distance et perspective – Deux métaphores »), comme indiqué plus haut, est certainement le plus central vis-à-vis du propos sous-jacent de l’ensemble du recueil. Carlo Ginzburg réendosse ici à la fois, par quelques chemins de traverse toujours aussi surprenants et réjouissants, sa critique du scepticisme généralisé d’un certain post-modernisme et sa conviction que l’histoire, entre autres, est avant tout peut-être affaire d’enquête et d’indices – on ne s’étonnera guère des résonances de cette thématique en sociologie, dans le très ultérieur (2012) « Énigmes et complots – Une enquête à propos d’enquêtes » de Luc Boltanski. Il nous offre une somptueuse lecture orientée, en moins de vingt pages, de saint Augustin, de Machiavel, et de Leibniz, rappelant judicieusement pour ce dernier qu’il fut le premier à extraire la notion de point de vue du seul registre optique.
x

Je m’en tiendrai à une seule remarque. Pour des raisons diverses, voire opposées, fondamentalistes et néo-sceptiques ont dénié ou ignoré ce qui, dans le passé, a fait de la perspective une métaphore cognitive dont nous avons mesuré la puissance : la tension entre un point de vue subjectif et une vérité objective et vérifiable que la réalité (comme chez Machiavel) ou Dieu (comme chez Leibniz) en soient donnés comme la garantie ultime. Si cette tension était maintenue, la notion de perspective cesserait de constituer un obstacle entre les sciences et les sciences sociales, pour devenir au contraire un lieu de rencontre, où la conversation, la discussion et la contradiction seraient possibles.
Le huitième et avant-dernier essai (« Tuer un mandarin chinois – Des conséquences morales de la distance »), s’il plonge ses racines dans l’étude de l’art oratoire judiciaire chez Aristote, s’ancre avant tout dans une brillante exégèse et dans une audacieuse actualisation de Denis Diderot (« Entretien d’un père avec ses enfants, ou du danger de se mettre au-dessus des lois », 1773) et de certains traités de casuistique jésuite, qui permet à Carlo Ginzburg de donner un sens nouveau, puissant et très actuel, à la parabole du mandarin (que l’on peut simplifier, abusivement sans doute, dans la forme canonique qui lui a donnée finalement l’erreur de remémoration due à Balzac dans « Le père Goriot », en : « ce que l’on ferait si l’on pouvait s’enrichir en tuant, par sa seule volonté et sans bouger de Paris, un vieux mandarin inconnu de nous, en Chine »), sens qui rejoindrait aisément la réflexion philosophique qui sous-tend, par exemple, la « Théorie du drone » (2013) de Grégoire Chamayou. En passant aussi par David Hume et par Walter Benjamin (« Sur le concept d’histoire », 1940), l’auteur nous invite encore à saisir en profondeur les conséquences morales quotidiennes de nos mises à distance.
Dans un monde que nous savons dominé par le sous-développement et par la cruauté de l’impérialisme, notre indifférence morale est déjà une forme de complicité. (…) On serait tenté de dire que les deux dernières générations ont reçu en dot, contrairement à ce que pensait Benjamin, une force messianique puissante – bien que négative. La fin de l’histoire – non pas dans le sens métaphorique aujourd’hui en vogue, mais dans un sens absolument littéral – est devenue dans le dernier demi-siècle une possibilité technique effective. La destruction virtuelle du genre humain, qui représente en tant que telle un tournant historique décisif, a influé et influera sur la vie et les fragments de mémoire de toutes les générations futures et passées, y compris celles qui, comme dit Aristote, « sont venues il y a dix mille ans ou viendront dans dix mille ans ». Le domaine de ce qu’Aristote appelait la « loi générale » semble parallèlement être devenu beaucoup plus vaste. Mais l’extension de notre compassion aux êtres humains les plus lointains resterait, je le crains, pure rhétorique. Notre capacité de contamination et de destruction du présent, du passé et du futur demeure incomparablement supérieure à notre pauvre imagination morale.
x


Discussion
Rétroliens/Pings
Pingback: Note de lecture : « Trompe-la-mort (Lionel Ruffel) | «Charybde 27 : le Blog - 20 avril 2019
Pingback: Note de lecture : « Frontières (Olivier Benyahya) | «Charybde 27 : le Blog - 17 avril 2020
Pingback: Note de lecture : « Inconstance des souvenirs tropicaux (Nathalie Peyrebonne) | «Charybde 27 : le Blog - 27 avril 2020