Un ouvrage particulièrement précieux pour s’y retrouver dans les représentations et analyses de l’effondrement, prospectives, spectaculaires marchandes ou idéologiques, et pour y discerner des chemins de changement encore praticables.
x
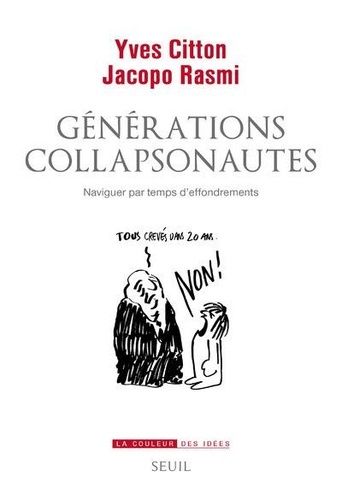
Le moment actuel nous semble en effet être celui d’un basculement d’époque. Comme on le verra plus en détail dans un chapitre ultérieur, les prédictions d’un effondrement écologique du capitalisme consumériste ne datent nullement de l’été 2018. Notre avenir effondré a été décrit, voire quantifié, depuis plusieurs décennies au sein de cercles minoritaires qui s’attiraient au mieux les réfutations, au pire les sarcasmes des leaders d’opinion et des gens raisonnables. Le basculement actuel tient à ce qu’une accumulation de données de moins en moins réfutables fait pencher de plus en plus de gens raisonnables – à commencer par celles et ceux d’entre nous distingué•e•s par le terme de scientifiques – vers des conclusions de plus en plus préoccupantes sur nos conditions de vie à venir. À force de s’entendre dire que, contrairement aux promesses multiséculaires de la modernité, la vie de nos enfants serait moins prospère que celle de leurs parents, lesdits enfants commencent à descendre dans les rues pour faire de leurs vendredis une école buissonnière qui ressemble à une grève de croissance.
Ce basculement s’écrira ici à quatre mains et à deux générations. Un sortant (58 ans) et un entrant (28 ans) tenteront de comprendre ensemble, l’un par l’autre, ce qu’il peut y avoir à dire et à faire dans ce monde aussi étonnant qu’inquiétant où l’effondrement annoncé fait l’objet de « c♥︎ups de cœur ». L’un de nous, fonctionnaire bien assis, commence à compter les années qui lui restent à vivre, se demandant qui, de son corps ou du milieu, s’écroulera le premier. L’autre, récemment doctoré, commence à se faire un place dans une société précarisée, où rien ne saurait être garanti. Même si le plus âgé a statistiquement moins de probabilités de voir le système actuel s’écrouler de son vivant, nul ne sait lequel de nous deux est le plus préoccupé par la hantise d’un effondrement prochain. Ensemble, nous nous situons à l’articulation centrale de cette « logique sociale de désillusion collective », bien analysée par Luc Semal, « qui se nourrit d’une rencontre inédite entre, d’une part, la génération pionnière de l’écologie politique qui arrive en fin de carrière militante en dressant un bilan à l’arrière-goût d’échec et, d’autre part, une jeune génération primo-militante qui se politise en acquérant la certitude qu’adviendront de son vivant de grandes ruptures écologiques ».
Ni pionniers ni blancs-becs, nous partageons le sentiment de faire partie de deux générations différemment mais communément affectées par cette hantise – deux générations collapsonautes, qui se sentent exposées ensemble au danger d’un délitement traumatique de leur mode de vie actuel, mais qui « veulent surtout apprendre à vivre avec ». Les collapsonautes pensent à l’effondrement, souvent avec angoisse, parfois avec obsession, ils parlent, elles calculent, militent, avertissent, dénoncent, débattent – mais le problème premier des collapsonautes est de parvenir à naviguer ensemble à travers les flots tumultueux des tempêtes présentes et à venir. Davantage que des certitudes à partager, nous avons deux perspectives existentielles à croiser, que nous espérons complémentaires, sur un désarroi commun. De ce partage, nous espérons dénicher quelques principes d’orientation, quelques voies d’avenir navigables et désirables, sur l’océan houleux où nous plongent les désastres environnementaux en cours.
En effet, même si le climato-négationnisme reste vivace (et abondamment financé) dans certains milieux, notre problème le plus grave n’est pas tellement à situer du côté de cercles cyniques ou machiavéliques qui nient activement des menaces que tout semble malheureusement corroborer. Il nous semble plutôt venir de notre acceptation passive de savoirs bien établis, que nous peinons dramatiquement à traduire en actions concrètes qui soient à la hauteur des défis du moment. Pour le dire avec l’humour de McKenzie Wark, il semble désormais avéré que le mouvement politique le plus irrésistible du XXIe siècle – plus puissant encore que tous les populismes dénoncés (et nourris par nos médias de masse – sera le Front de libération du carbone (FLC). Rien ne paraît capable de l’arrêter dans sa progression séculaire exponentielle.
Comment reconnaître que nous allons subir des effondrements en chaîne, sans pour autant nous résoudre au pire ? Comment échapper à la paralysie et à l’inertie, tandis que nous occupons simultanément, ou alternativement, les places du lapin ébloui par les phares et du conducteur grisé par la vitesse ? Comment regarder en face ce qui est sur le point de nous écraser, alors que ce sont nos espoirs et nos rêves de prospérité qui s’effondrent sur nous ?
Davantage qu’à répondre à de telles questions, notre effort visera à les défléchir. En croisant nos regards, nous espérons faire émerger d’autres façons de voir et de penser les effondrements qui nous menacent. Non tant pour les conjurer que pour en esquiver les pires effets – voire pour y trouver des occasions de rebonds salutaires. La sensibilité effondriste, telle qu’elle s’affirme dans le débat contemporain, constituera pour nous un prisme – observé par de multiples perspectives – à travers lequel repérer et discuter les nœuds, les trajectoires et les possibles de notre époque hantée par la question écologique.
x

Publié en mars 2020, quelques jours avant le premier confinement, dans la collection La couleur des idées du Seuil, l’ouvrage d’Yves Citton et de Jacopo Rasmi courait le risque de passer un peu trop inaperçu, ce qui serait fort dommage : il s’agit en effet de l’une des études les plus pertinentes qui soient sur la manière d’appréhender la place – ou plutôt les places, car beaucoup d’entre elles sont largement divergentes – que tient dans nos imaginaires contemporains la thématique de l’effondrement.
En analysant finement un vaste corpus de représentations contradictoires, en triant pour nous parmi les visions naïves, celles qui ressortent d’une étrange schadenfreude et celles qui sont tout sauf désintéressées (religions et idéologies étant ici plus que jamais à l’affût), les deux chercheurs – qui connaissent bien la manière dont s’organisent les storytellings contemporains, jusque dans leur foisonnement apparemment incohérent, comme en témoignent notamment, parmi les ouvrages précédents d’Yves Citton, « Mythocratie » ou « Médiarchie » – s’appuient sur un certain nombre de sherpas prestigieux et de défricheuses sérieuses, à limage, pour n’en citer que quelques-un(e)s, des logiquement incontournables Pablo Servigne ou Bruno Latour, des irrévérencieuses McKenzie Wark ou Corinne Morel Darleux, des expérimentées Isabelle Stengers ou Jean-Pierre Dupuy, des spécialistes des littératures de l’imaginaire que sont Ariel Kyrou, Yannick Rumpala ou Jean-Paul Engélibert, des points de vue décoloniaux tels ceux d’Achille Mbembe ou de Felwine Sarr, ou encore des précurseurs Michaël Foessel ou René Thom. Ils ne dédaignent toutefois pas, loin de là, celles et ceux qui s’aventurent aux limites de l’enveloppe des possibles (ou plutôt de l’appréhension de ces possibles) – quitte à provoquer alors des réactions plus sceptiques voire amusées -, voire certains francs charlatans, tandis que les opportunistes des développements personnels millénaristes seront pointés du doigt au passage, et que les agendas à peine cachés des plus enragés des survivalistes apparaîtront en pleine lumière.
Voilà donc – au moins – un demi-siècle que les dénonciations se multiplient, que les avertissements circulent, que les données s’accumulent, que les facteurs se précisent, que les explications s’approfondissent. Cinquante ans aussi que les énormes intérêts en place, financiers, pétroliers, agro-industriels, alternent entre le déni agressif et les déclarations de bonnes intentions non suivies d’effets, bien décidés à s’agripper à leurs sources de profits aussi longtemps qu’une force supérieure ne les en décrochera pas.
Bien sûr, à l’échelle des évolutions anthropologiques et des périodes géologiques où nous place le vocabulaire du Plantationocène, cinquante années passent avec la rapidité d’un clin d’œil. Dès lors qu’il s’agit d’opérer une mutation radicale dans nos façons de concevoir les finalités de la vie commune, la mesure des valeurs, les missions des institutions, ainsi que la nature même de notre insertion dans nos environnements, on ne saurait s’étonner ni des résistances, ni des hésitations, ni des désarrois, ni des procrastinations qui ralentissent ou paralysent temporairement les changements à opérer. Même si tout avait été déjà dit, argumenté, modélisé dès 1979 (ce qui n’est évidemment pas le cas), il aura bien fallu laisser le temps à des idées aussi dérangeantes de faire leur chemin, depuis les pages des rapports savants jusqu’aux législations politiques et jusqu’aux pratiques quotidiennes.
x

Avec la curiosité presque illimitée qui caractérise la constitution de leur corpus de représentations (on appréciera tout particulièrement, pour illustrer superbement le néologisme collapsonautes, l’exhumation d’images – voir ci-contre – issues du film de 1975 d’Artavazd Pelechian, « Les saisons »), associant romans, films, séries télévisées, œuvres issues des arts plastiques ou des performances théâtrales, publicités, les deux chercheurs nous offrent un travail salutaire à plus d’un titre, tonique et analytique, pour nous permettre, par un chemin différent de celui emprunté par Alice Carabédian et son « Utopie radicale », mais parfaitement cohérent avec celui-ci, de nous défaire de la sidération dystopique, d’aller nettement « par-delà l’imaginaire des cabanes et des ruines », et d’entamer le remontage du futur.
Pour celles et ceux qui ne se complaisent pas dans la nostalgie, le déclinisme ou la fuite en avant techno-souverainiste, le remontage du futur est plutôt à concevoir comme un bricolage artisanal, hasardeux et incontrôlé. Avant de programmer un menu bouffi de bonnes intentions, il commence par compter (sur) les ingrédients et les amitiés qui sont à portée de main, dans un art convivial d’accommoder les restes. Même si un nombre intolérable de Terrestres souffrent actuellement de manques et de maltraitances imposées par les chaînes de montage et d’approvisionnement héritées du Plantationocène, nous avons d’ores et déjà – tou•te•s ensemble – largement de quoi satisfaire nos vrais besoins. Avant de se demander que faire, les commensaux de cette table de remontage du futur chercheront à savoir aux côtés de qui et avec quoi. « Ce qui sera (fait) » dépend de ce que nous avons et partageons avec nos coexistant•e•s – non de ce qui frustre nos rêves de pouvoir.
Ceci est du montage. Le graffiti tagué sur la voiture de Santiago vaut aussi pour l’ouvrage qui s’achève ici, sur la reconnaissance de son évidente incomplétude. Nous avons dû nous mettre non seulement à deux, signataires de ce livre, mais à des dizaines d’auteur•e•s, cité•e•s en chemin, pour nous repérer dans les annonces d’effondrement qui nous entourent, nous habitent et nous hantent. En pratiquant les arts du montage sur ces citations hétérogènes, parfois contradictoires entre elles, nous avons espéré sortir par le haut du plan-séquence de la collapsologie, en multipliant les coupes et les raccords, en diversifiant les focales et les angles de vue, les sensibilités et les croyances – au-delà de toute prétention à la souveraineté individuelle ou collective.
Le livre qui en résulte – notre coup monté – ne prétend qu’à « la richesse d’une précarité qui va de main en main, comme une caresse ». Sa vérité, s’il en porte une, tiendra moins à nos intentions d’auteurs qu’à « ce qui en sera (fait) », qu’à ce qui en sera remonté par la coexistence de nos attentions plurielles. Ce remontage d’un futur commun à nos générations collapsonautes, si étonnamment avides de choisir nos c♥︎ups de cœur dans ce qui nous donne des crises cardiaques, nous poussera à chérir ce qui nous reste, plutôt qu’à regretter (par avance) ce qui nous manquera – à aimer les faiblesses qui nous unissent, plutôt que les souverainetés qui nous enlisent. Nous ne naviguerons par temps d’effondrements qu’en apprenant à faire tenir ensemble nos incomplétudes partagées.
x


Discussion
Rétroliens/Pings
Pingback: Note de lecture : « La poésie du futur (Srećko Horvat) | «Charybde 27 : le Blog - 21 août 2022
Pingback: Planète B (Blast) : Épisode 2 | Charybde 27 : le Blog - 30 octobre 2022
Pingback: Note de lecture : « Lendemains qui hantent (Gabriel Berteaud) | «Charybde 27 : le Blog - 19 août 2023