L’exil inguérissable et le retour inéluctable des souvenirs.
x
Ce récit ponctué de photographies de l’auteur, publié en 1992, et traduit en 1999 par Patrick Charbonneau pour les éditions Actes Sud, juxtapose les biographies littéraires de quatre hommes hantés par des fantômes de souvenirs indéfinissables, indéfinissables sans doute car l’horreur ne peut être dite frontalement. Le narrateur des «Émigrants» restitue, à partir de traces patiemment recueillies, les histoires de ces individus hantés par l’exil et la disparition, par des souvenirs traumatiques qui un jour les rattrapent, inéluctablement.
Le narrateur rencontre le premier de ces hommes, le Dr Henry Selwyn, tandis qu’il cherche à emménager fin septembre 1970 dans l’est de l’Angleterre, dans les environs de Norfolk. Il va habiter pendant quelques mois dans la maison de ce chirurgien à la retraite, désormais coupé du monde et se sentant de plus en plus étranger dans son propre pays. Le narrateur explore par touches le retour du souvenir de l’exil de la famille juive lituanienne de Selwyn vers l’Angleterre, dans les dernières années du XIXème siècle ; les images effacées de cet exode resurgissent, irrépressibles, à la manière de la dépouille de ce guide de montagne de Bern qui fut l’ami de Selwyn dans sa jeunesse, disparu en 1914 en montagne et restitué par un glacier suisse sept décennies plus tard.
«Au bout d’une semaine environ, beaucoup plus tôt que nous ne l’avions escompté, nous arrivions à destination. Nous entrâmes dans une large embouchure de fleuve. Il y avait des cargos partout, des grands et des petits. De l’autre côté de l’eau s’étendait une terre plate. Tous les émigrants s’étaient rassemblés sur le pont et attendaient que surgisse de la brume mouvante la statue de la Liberté, car tous avaient acheté un passage pour l’Amerikum – comme on l’appelait chez nous. Quand nous touchâmes terre, il ne faisait pour nous aucun doute que nous foulions le sol du Nouveau Monde, de la ville promise de New-York. Mais en réalité, comme il s’avéra à notre grand regret au bout de quelque temps – le bateau était reparti depuis belle lurette -, nous avions accosté à Londres. La plupart des émigrants se firent, contraints et forcés, une raison, mais quelques-uns néanmoins, en dépit de toutes les preuves contraires, persistèrent à croire qu’ils se trouvaient en Amérique.»
Le narrateur entend parler à nouveau de Paul Bereyter, qui fut son instituteur au début des années 1950, lorsque celui-ci met fin à ses jours en 1984 de manière atroce à l’âge de soixante-quatorze ans. L’article annonçant sa mort mentionne incidemment que ce pédagogue talentueux et excentrique, obsédé par les chemins de fer, ne put exercer sa profession sous le Troisième Reich. À partir de là, Paul Bereyter devient progressivement et sur plusieurs années, un objet central des préoccupations du narrateur, jusqu’à ce qu’il en vienne à tenter de percer de l’histoire de cet homme très secret, consumé par le désespoir et la solitude. Ainsi, les récits des «Émigrants» agissent comme des immersions progressives dans les couches de la mémoire, au fil des enquêtes et témoignages, s’appuyant sur des lieux et des dates précises qui contrastent avec la réapparition lancinante et mélancolique d’un passé émaillé de blancs, au fil de longues phrases sinueuses au rythme hypnotique.
«Les chemins de fer revêtaient pour Paul une profonde signification. Vraisemblablement avait-il toujours pensé qu’ils menaient à la mort. Les itinéraires, les horaires, les indicateurs, toute la logistique ferroviaire étaient à certaines périodes devenues pour lui, comme son appartement de S. le trahissait aussitôt, une véritable obsession.»
 Le troisième personnage, Ambros Adelwarth, était le grand-oncle du narrateur, un homme fort distingué né en 1886, contraint de travailler très tôt et n’ayant donc jamais eu ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une enfance. Intrigué par un album de photographies familial, le narrateur entreprend un voyage aux Etats-Unis en 1981, à la recherche des traces de l’histoire de cet homme. Emigré d’Allemagne à l’adolescence, ayant travaillé et voyagé à travers le monde, et enfin entré au service d’une des familles de banquiers juifs les plus riches de New-York, Ambros Adelwarth était devenu le valet de chambre et compagnon de voyage du fils, Cosmo Salomon, «connu dans la haute société new-yorkaise pour son extravagance et ses incartades perpétuelles ». Après la déroute mentale du fils et de la famille, Ambros Adelwarth, qui n’a jamais existé comme personne privée ayant toujours été au service des autres, est à son tour rattrapé par la mélancolie, la folie et interné. Toute l’œuvre de W. G. Sebald, né en 1944 et exilé en Angleterre en 1966, est placée sous le signe de la mélancolie et se retourne sur les traces de la destruction, de la guerre et de souvenirs qu’il n’a lui-même pas vécus.
Le troisième personnage, Ambros Adelwarth, était le grand-oncle du narrateur, un homme fort distingué né en 1886, contraint de travailler très tôt et n’ayant donc jamais eu ce qui pourrait ressembler de près ou de loin à une enfance. Intrigué par un album de photographies familial, le narrateur entreprend un voyage aux Etats-Unis en 1981, à la recherche des traces de l’histoire de cet homme. Emigré d’Allemagne à l’adolescence, ayant travaillé et voyagé à travers le monde, et enfin entré au service d’une des familles de banquiers juifs les plus riches de New-York, Ambros Adelwarth était devenu le valet de chambre et compagnon de voyage du fils, Cosmo Salomon, «connu dans la haute société new-yorkaise pour son extravagance et ses incartades perpétuelles ». Après la déroute mentale du fils et de la famille, Ambros Adelwarth, qui n’a jamais existé comme personne privée ayant toujours été au service des autres, est à son tour rattrapé par la mélancolie, la folie et interné. Toute l’œuvre de W. G. Sebald, né en 1944 et exilé en Angleterre en 1966, est placée sous le signe de la mélancolie et se retourne sur les traces de la destruction, de la guerre et de souvenirs qu’il n’a lui-même pas vécus.
«La dernière notation que mon grand-oncle fit dans son petit agenda date de la Saint-Etienne. Cosmo, peut-on lire, avait été pris d’une forte fièvre après le retour a Jérusalem, mais était déjà en bonne voie de rétablissement. En outre, le grand-oncle indiquait que la veille, dans les dernières heures de l’après-midi, il s’était mis à neiger et que, contemplant par la fenêtre de l’hôtel la ville blanche flottant dans les ombres naissantes du crépuscule, le passé avait resurgi en force dans sa mémoire. Le souvenir, ajoutait-il dans un post-scriptum, m’apparaît souvent comme une forme de bêtise. On a la tête lourde, on est pris de vertige, comme si le regard ne se portait pas en arrière pour s’enfoncer dans les couloirs du temps révolu, mais plongeait vers la terre du haut d’une de ces tours qui se perdent dans le ciel.»
 Brouillant la relation entre réalité et littérature, entre auteur et narrateur, c’est par le récit de son propre exil en Angleterre en 1966 que le narrateur débute le dernier chapitre des «Émigrants» consacré à Max Ferber, juif allemand exilé à Manchester en 1939 à l’âge de quinze ans, peintre hanté par le paysage industriel, les cheminées et la poussière de Manchester, écho aux cendres du pays perdu et à la destruction qui finissent par retomber sur les hommes après des décennies, les entraînant dans la mélancolie, la folie et le suicide.
Brouillant la relation entre réalité et littérature, entre auteur et narrateur, c’est par le récit de son propre exil en Angleterre en 1966 que le narrateur débute le dernier chapitre des «Émigrants» consacré à Max Ferber, juif allemand exilé à Manchester en 1939 à l’âge de quinze ans, peintre hanté par le paysage industriel, les cheminées et la poussière de Manchester, écho aux cendres du pays perdu et à la destruction qui finissent par retomber sur les hommes après des décennies, les entraînant dans la mélancolie, la folie et le suicide.
«Au fil des années que j’ai passées depuis entre les façades noires de ce berceau de notre industrie j’ai réalisé that I am here, as they used to say, to serve under the chimney.»
X


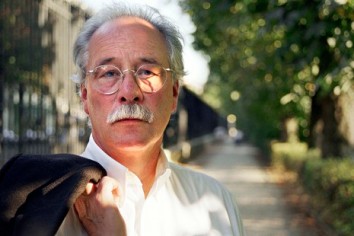

Discussion
Rétroliens/Pings
Pingback: Les lectures les plus marquantes de Charybde 7 en 2016. | Charybde 27 : le Blog - 7 janvier 2017
Pingback: Note de lecture : « Les anneaux de Saturne (W.G. Sebald) | «Charybde 27 : le Blog - 12 mars 2017
Pingback: Note de lecture : « Vertiges (W.G. Sebald) | «Charybde 27 : le Blog - 6 avril 2017
Pingback: Note de lecture : « Austerlitz (W. G. Sebald) | «Charybde 27 : le Blog - 29 Mai 2017
Pingback: Note de lecture : « Les huit montagnes (Paolo Cognetti) | «Charybde 27 : le Blog - 27 décembre 2017
Pingback: Note de lecture : « Un monde sans rivage (Hélène Gaudy) | «Charybde 27 : le Blog - 13 août 2019