Une extraordinaire tentative de théodicée, à partir de matériau anthropologique et science-fictif de premier choix.
x
RELECTURE – PREMIÈRE LECTURE EN VERSION ORIGINALE AMÉRICAINE

Ce premier roman de 1996, œuvre d’une paléo-anthropologue de quarante-six ans, spécialisée jusqu’alors dans les études néanderthaliennes, mais aussi admiratrice de longue date de la littérature de science-fiction en général, et des travaux d’Ursula K. Le Guin et d’Orson Scott Card en particulier, constitue sans doute l’une des plus belles réussites de la littérature contemporaine de spéculation scientifique et humaine, joignant dans un équilibre quasiment parfait l’authentique expérience de pensée et la tension narrative et émotionnelle.
Rétrospectivement, la chose était prévisible. Tout, dans l’histoire de la Compagnie de Jésus, montrait qu’elle alliait le savoir-faire au sens de l’efficacité, le goût de l’exploration à celui de la recherche. Au cours de ce que les Européens se plaisaient à appeler l’âge des Grandes Découvertes, les prêtres jésuites n’étaient jamais arrivés plus d’un an ou deux après ceux qui avaient noué des rapports avec des peuples jusque-là inconnus ; ils étaient même, bien souvent, à l’avant-garde des explorateurs.
Il fallut des années aux Nations unies pour parvenir à une décision que la Compagnie de Jésus prit en dix jours. À New York, les diplomates multiplièrent les débats acharnés, ponctués d’innombrables suspensions et ajournements, afin de savoir s’il fallait consacrer des ressources humaines à une éventuelle prise de contact avec le monde que l’on connaîtrait ensuite sous le nom de Rakhat, alors qu’il y avait sur Terre tant de besoins pressants, et pourquoi. À Rome, les questions que l’on se posa n’étaient pas si et pourquoi, mais dans quel délai la mission pourrait être tentée et qui envoyer.
La Compagnie ne demanda la permission d’aucun gouvernement temporel. Elle agit conformément à ses propres principes, avec ses propres capitaux et sous l’autorité du pape. Et la mission vers Rakhat fut entreprise non pas tant secrètement que confidentiellement – distinguo subtil, mais que la Compagnie ne se sentit nullement tenue d’expliquer ou de justifier lorsque la nouvelle fit les gros titres de l’actualité quelques années plus tard.
Les scientifiques jésuites partirent apprendre et non convertir. Ils partirent parce qu’ils voulaient connaître les autres enfants de Dieu, parce qu’ils voulaient les aimer. Ils partirent pour la raison qui a toujours poussé les jésuites vers les frontières extrêmes de l’exploration humaine. Ils partirent ad majorem Dei gloriam, pour la plus grande gloire de Dieu.
Ils ne pensaient pas à mal.
x
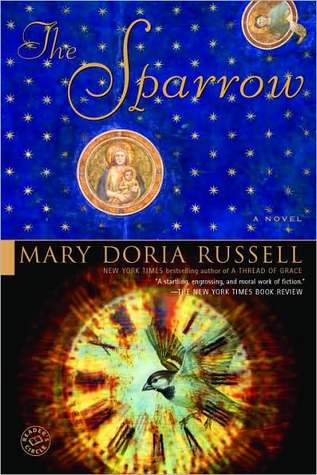
Le pari était diablement (si l’on ose dire) audacieux, pour donner de la crédibilité et de l’épaisseur à l’un de ces postulats qui auraient fait la joie de la science-fiction de l’âge héroïque, mais auraient pu provoquer une vague gêne honteuse une fois le bouillon refroidi : « Des Jésuites dans l’espace ! ». S’appuyant sur un colossal travail de documentation et sur de nombreuses rencontres de spécialistes des divers domaines autres que le sien propre à l’origine (depuis la physique interstellaire – même si là, il ne s’agissait pas d’atteindre la vérisimilitude mais de dégager un cadre suffisant – jusqu’à la théologie, de la zoologie à la sociologie, en passant par l’économie et la psychologie), Mary Doria Russell l’a largement réussi, et nous offre l’un de ces textes qui sont à même de changer subrepticement une lectrice ou un lecteur. Pour cela, elle a conçu une redoutable mécanique narrative, posant d’emblée ou presque certaines cartes maîtresses sur la table (l’expédition jésuite a eu lieu, et bien des années après, un seul survivant a pu en être récupéré, ce survivant lui-même étant sévèrement traumatisé d’une part, gravement entaché de doute quant à sa conduite d’autre part), pour reconstruire par de fort habiles successions de flashbacks la genèse du voyage vers ce « premier contact » extra-terrestre, le déroulement de l’expédition proprement dite, et le processus d’extraction des données détenues dans l’intimité de son psychisme par le père Emilio Sandoz, le seul survivant en question, à son désastreux retour.
Jimmy n’était pas un imbécile, mais il avait été tendrement chéri par d’excellents parents et soigneusement instruit par de bons professeurs, deux faits susceptibles d’expliquer cette habitude d’obtempérer qui mystifiait Peggy Soong et la mettait hors d’elle. À d’innombrables reprises, au cours de sa vie, il avait pu constater que les autorités avaient raison et qu’en dernière analyse, les décisions de ses parents et de ses maîtres lui paraissaient sensées. En conséquence de quoi, il n’était pas ravi, bien sûr, de voir ses fonctions à l’observatoire d’Arecibo confiées à un système d’intelligence artificielle, mais, livré à lui-même, il n’aurait sans doute pas protesté. Il n’y travaillait que depuis huit mois : ce n’était pas assez pour se sentir des droits imprescriptibles sur un emploi qu’il n’avait obtenu que grâce à un incroyable coup de pot. Car enfin, il n’avait pas décroché ses diplômes d’astronome en s’attendant à débarquer ensuite sur un marché du travail en plein boom. Les astronomes gagnaient des clopinettes et la lutte pour l’emploi était féroce, mais désormais, c’était à peu près pareil dans tous les secteurs. Sa mère – une femme petite et crampon – avait insisté pour qu’il fît des études débouchant sur quelque chose de plus concret, mais Jimmy s’en était tenu à l’astronomie : quitte à ne pas avoir de travail, comme les statistiques le laissaient prévoir, autant ne pas en avoir dans la profession de son choix, avait-il déclaré.
x
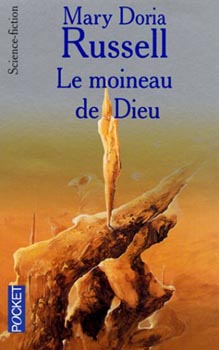
Démarrant avec un hommage au programme SETI (Porto-Rico joue d’ailleurs un rôle de creuset plutôt essentiel dans le roman) et au « Contact » (1985) de Carl Sagan (qui est même cité au fil du récit), voire avec un écho subtil du « Vol avec effraction douce » (1991) de Bernard Lenteric, lorsqu’il s’agit d’ « accoucher » le savoir-faire de spécialistes pour en nourrir des intelligences artificielles, « Le moineau de Dieu », placé sans ambiguïtés sous le signe du questionnement religieux – mais pas uniquement, se démarque très vite de ses ancêtres éloignés, « Projet Vatican XVII » (1981) de Clifford Simak ou « Un cantique pour Leibowitz » (1959) de Walter Miller Jr., ou plus directs (« Un cas de conscience » (1953) de James Blish est mentionné par Mary Doria Russell dans ses inspirations), pour développer une ambitieuse théodicée (c’est-à-dire « une explication de l’apparente contradiction entre l’existence du mal et deux caractéristiques propres à Dieu, sa toute-puissance et sa bonté », nous rappelle Wikipedia), remarquablement digeste, mêlant inextricablement l’humour véritable et le vertige métaphysique, en ménageant de redoutables rebondissements narratifs bien au-delà des attentes légitimes de la lectrice ou du lecteur.
Elle le dévisagea un moment, interloquée. « Vous n’êtes vraiment pas au courant, hein ? demanda-t-elle. Vous avez dû mener une vie très protégée, j’imagine. »
Ce fut au tour d’Emilio de la regarder sans comprendre.
« Vous ne savez donc pas ce que signifie ceci ? » continua-t-elle en indiquant le bracelet de métal qu’elle portait toujours. Il l’avait remarqué, bien sûr, ce bijou plutôt passe-partout, en accord avec le goût de Sofia pour les toilettes sobres. « Je ne reçois que le strict minimum pour vivre. Mes honoraires vont à mon agent. Il m’a mise sous contrat quand j’avais quinze ans. C’est lui qui a payé mes études et, tant que je n’aurai pas remboursé tout ce qu’il a investi, il est illégal de m’employer directement. Je ne peux pas retirer ce bracelet d’immatriculation. Il est là pour protéger les intérêts de mon agent. Je croyais que tout le monde était au courant de ce genre d’arrangement.
– Mais enfin, ça ne peut pas être légal ! s’écria-t-il quand il eut retrouvé l’usage de la parole. C’est de l’esclavage.
– Peut-être serait-il plus exact de dire que c’est de la prostitution intellectuelle. Sur le plan juridique, cela ressemble plus à un contrat d’apprentissage qu’à de l’esclavage, Dr Sandoz. Je ne suis pas liée à lui pour la vie. Quand j’aurai remboursé ma dette, je serai libre de le quitter. » Tout en parlant, elle ramassa ses affaires, prête à s’éclipser. « Et sachez que je trouve cet arrangement préférable à la prostitution physique. »
Là, c’était plus qu’il n’était capable d’en absorber. » Où allez-vous, à présent ? demanda-t-il, toujours abasourdi.
– À l’École de guerre de l’armée américaine. Il y a un professeur d’histoire militaire qui part à la retraite. Au revoir, Dr Sandoz. »
Il lui serra la main et la regarda partir. La tête haute, un port de princesse.
x
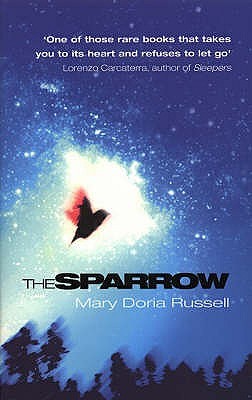
« Le moineau de Dieu » doit une grande partie de sa sombre et fascinante magie à la qualité des personnages et de leurs psychologies visibles, dans toute leur variété, mais sans doute surtout à la profondeur du travail authentiquement anthropologique (fût-il entrepris à propos de civilisations fictives) mis ici en œuvre par Mary Doria Russell. L’héritage de l’Ursula K. Le Guin des romans de l’Ekumen, et tout particulièrement du célébré « La main gauche de la nuit » (1969) – mais aussi de l’Eleanor Arnason de « A Woman of the Iron People » (1991) – est patent, et d’ailleurs justement revendiqué et reconnu par l’auteur, mais c’est certainement à « La voix des morts » (1986) d’Orson Scott Card qu’elle reconnaît devoir le plus dans son approche initiale. Si l’auteur mormon confie ses préoccupations religieuses profondes à ses cycles d’ « Alvin le Faiseur » ou de « La Terre des Origines » plutôt qu’à celui d’ « Ender », dont « La voix des morts » constituait le deuxième volume, le traitement de la notion même de malentendu culturel, au sens anthropologique du terme, y est bien entendu essentiel (et l’on notera d’ailleurs qu’une partie de la cruauté rituelle et quasiment ontologique qui baignait le redoutable « Espoir-du-Cerf » dès 1983 est bien présente ici aussi).
Edward ne sait pas quoi penser de l’assassinat de la petite Askama, ni de la violence prétendûment déclenchée par les missionnaires jésuites. Mais, en revanche, si Emilio Sandoz, mutilé, misérable, désespérément seul, s’est livré à la prostitution, qui a le droit de lui jeter la pierre ? Pas Edward Behr, toujours, qui sait à quoi s’en tenir sur la force de caractère de cet homme et sur tout ce qu’il a fallu lui infliger pour le ravaler à l’état dans lequel on l’a trouvé sur Rakhat. Johannes Voelker, par contre, est convaincu que Sandoz n’est qu’un dangereux voyou qui a sombré dans de monstrueux excès en l’absence d’autorité extérieure. Nous sommes ce que nous redoutons chez les autres, se dit Edward, et il se demande à quoi Voelker emploie ses loisirs.
x

Le personnage Supaari Va’Gayjur, vu par l’artiste Dana Vertongen
Après avoir donné en 1998 une suite (« Children of God », non traduit en français à ce jour) au « Moineau de Dieu », lui-même couronné de prix fort prestigieux tels que le prix Arthur C. Clarke, le Grand Prix de la Science-Fiction Britannique ou le prix James Tiptree, Mary Doria Russell a poursuivi ses spéculations à la fois puissantes et pleinement distrayantes aux frontières d’autres genres, et notamment du roman historique. Traduit en français en 1998 chez Albin Michel par Béatrice Vierne, puis réédité chez Pocket en 2001, ce magnifique ouvrage longtemps épuisé est à nouveau disponible depuis juin 2017 grâce aux éditions ActuSF, qu’il faut ici saluer. Un beau moyen de les récompenser serait naturellement, pour vous toutes et tous qui ne lisez habituellement guère de littérature dite de science-fiction, de vous précipiter sur ce roman, qui ne vous déroutera probablement pas – même si vous êtes peu familiers du genre – et ne vous décevra certainement pas. De l’intense spéculation et de la grande littérature, qui se dévore, c’est promis.
Cette année-là, quelques superbes œuvres d’art de la Renaissance furent vendues sans aucune publicité à des investisseurs privés. Lors d’une vente aux enchères à Londres, on fixa un prix pour une collection de porcelaines orientales du XVIIe siècle considérée jusque-là comme inestimable. Certaines propriétés détenues depuis longtemps et divers portefeuilles d’actions furent discrètement mis sur le marché, à des intervalles soigneusement calculés et dans des lieux rigoureusement choisis, où des plus-values considérables pouvaient être réalisées à la vente.
Il s’agissait de faire des profits, de liquider certains avoirs, de redistribuer du capital. La somme nécessaire, comme l’avait prédit Sofia Mendes, n’était pas insignifiante, mais elle fut loin de mettre la Compagnie de Jésus sur la paille et elle n’affecta même pas les missions et les bonnes œuvres dont elle s’occupait sur la Terre, lesquelles étaient financées grâce aux revenus provenant d’établissements d’enseignement et de recherche, de contrats de location et de brevets de fabrication. La somme ainsi réunie fut déposée dans une banque viennoise relativement discrète. Tout autour du globe, on ordonna à divers membres de la Compagnie de surveiller les médias et les réseaux de données, afin d’y déceler la moindre mention de l’activité financière des jésuites et de transmettre ces renseignements aux bureaux du général, à la Curie généralice. D’un bout de l’année à l’autre, personne ne remarqua rien.
x


Discussion
Rétroliens/Pings
Pingback: Note de lecture : « La voix des morts (Orson Scott Card) | «Charybde 27 : le Blog - 18 juillet 2017
Pingback: Note de lecture : « Les enfants de l’esprit (Orson Scott Card) | «Charybde 27 : le Blog - 2 août 2017
Pingback: Note de lecture : « La trilogie de Jéhovah (James Morrow) | «Charybde 27 : le Blog - 21 Mai 2018