Dans la campagne anglaise contemporaine, au milieu des clichés et des parodies, la première enquête d’une improbable détective amatrice, savamment antipathique et bizarrement savoureuse.
x

C’est par une amie fidèle lectrice, comme moi, de la saga Salvo Montalbano d’Andrea Camilleri (qui débutait en 1994 avec « La forme de l’eau » pour atteindre désormais 27 volumes traduits en français) que j’ai découvert Agatha Raisin, l’enquêtrice britannique résolument improbable imaginée par M.C. Beaton, l’un des nombreux pseudonymes de Marion Chesney, autrice prolifique décédée en 2019. Publié en 1992, traduit en 2016 par Esther Ménévis chez Albin Michel, « La quiche fatale » est le premier des 31 épisodes de cette série extrêmement populaire, au Royaume-Uni et dans le monde entier.
« Bien sûr, c’est Mrs. Cartwright qui va gagner le concours de quiches », fit une voix près d’Agatha.
Elle se retourna brusquement.
« Pourquoi dites-vous ça ? demanda-t-elle.
– Parce que c’est Mr. Cummings-Browne qui juge », dit l’autre, avant d’aller se perdre dans la foule.
Le nom de la gagnante serait annoncé, non pas par Mr. Cummings-Browne, mais par lord Pendlebury, un gentleman maigre et âgé qu’on aurait dit sorti d’une histoire de fantômes de l’ère édouardienne, propriétaire d’un domaine sur la colline surplombant le village.
On préleva une fine part de la quiche d’Agatha, comme de toutes les autres. Elle regarda son « œuvre » d’un air suffisant. Hourra pour la Quicherie ! Il ne faisait aucun doute que sa tarte aux épinards sortait du lot. Le fait qu’elle était censée l’avoir préparée elle-même ne troublait pas sa conscience pour un sou.
L’orchestre se tut. On aida lord Pendlebury à monter sur l’estrade pour le rejoindre.
« La gagnante du grand concours de quiches est… », chevrota-t-il. Il tripota ses notes, les ramassa, les remit en ordre, sortit un pince-nez, lança de nouveau un regard désespéré à ses feuilles, jusqu’à ce que Mr. Cummings-Browne lui indique la bonne.
« Miséricorde ! Oui, oui, oui, radota le vieillard. Hem, hem ! La gagnante est… Mrs. Cartwright.
– Nom d’un salopard à sonnette ! » grommela Agatha.
Furibarde, elle regarda la dite Mrs. Cartwright, une femme aux allures de bohémienne, monter sur l’estrade recevoir sa récompense. Un chèque.
« C’est combien ? s’enquit Agatha auprès de sa voisine.
– Dix livres.
– Dix livres ! » Même si elle ne s’était jamais, jusqu’ici, renseignée sur la récompense, elle avait naïvement supposé qu’elle se présenterait sous la forme d’une coupe en argent. Elle avait imaginé cette coupe avec son nom gravé dessus posé sur le manteau de sa cheminée. « Comment est-ce qu’elle est censée fêter sa victoire avec ça ? En allant dîner au McDo ?
– C’est l’intention qui compte, répondit sa voisine d’une air vague. Vous êtes Mrs. Raisin. Vous venez d’acheter le cottage de Budgen. Je me présente : Mrs. Bloxby, l’épouse du pasteur. Pouvons-nous espérer vous voir à l’office, dimanche ?
– Pourquoi Budgen ? J’ai acheté le cottage à un certain Mr. Alder.
– Ça a toujours été le cottage de Budgen. Cela fait quinze ans qu’il est décédé, bien sûr, mais pour nous, gens du village, ce sera toujours le cottage de Budgen. C’était un homme exceptionnel. Au moins, vous n’avez pas à vous inquiéter de votre repas de soir, Mrs. Raisin. Votre quiche a l’air délicieuse.
– Oh ! mettez-là à la poubelle ! cracha Agatha. C’était la mienne, la meilleure. Ce concours est truqué. »
Mrs. Bloxby lui lança un regard de reproche attristé, puis s’éloigna.
Elle éprouva un sentiment de malaise. Elle n’aurait pas dû dire de vacherie à l’épouse du pasteur à propos du concours. Mrs. Bloxby avait l’air d’une femme gentille. Mais en matière de conversation, Agatha n’était habituée qu’à trois registres : autoritaire avec ses employés, insistant avec les médias, onctueux avec ses clients. Une vague idée commençait à germer dans un coin de sa tête : Agatha Raisin n’était pas quelqu’un de très sympathique.
x
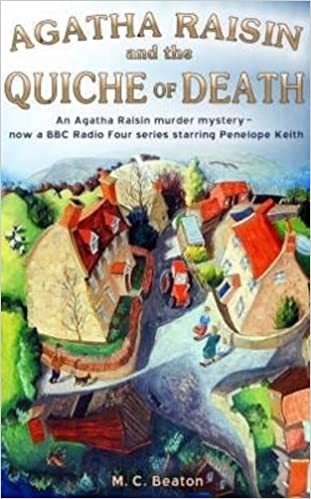
Ayant vendu pour une somme rondelette son agence londonienne de relations publiques, la self-made-woman cinquantenaire Agatha Raisin, originaire des quartiers les plus pauvres de Birmingham, a acheté un charmant cottage dans un petit village situé au cœur des Costwolds, région de collines à une heure et demie à l’ouest de Londres, fort touristique et particulièrement à la mode désormais. Dotée d’un tempérament nettement fougueux – certains diraient irascible -, elle entreprend aussitôt, à sa manière aussi tonitruante que maladroite, de conquérir les esprits et les cœurs des habitants, ne s’imaginant pas une autre position sociale que celle de reine virtuelle du village, alors même qu’elle ne maîtrise guère les codes réels de cet environnement. Quiproquos incessants, impairs sans nombre, palinodies et suppositions infondées, ce véritable éléphant dans un magasin de porcelaine se retrouve presque d’emblée plongé aux toutes premières loges d’un tragique et mortel empoisonnement lors du concours local de quiches, qu’elle voulait ardemment remporter – en n’ayant pas une seconde hésité à se procurer son propre objet de concours auprès d’un réputé traiteur londonien.
Davantage sans doute que la galerie de portraits qui se met en place dès ce premier épisode, galerie pour laquelle M.C. Beaton manie les clichés de la société et de la countryside britanniques avec allégresse, d’une manière qui provoquera l’amusement ou l’agacement selon les lectrices et les lecteurs, c’est peut-être un pari relativement rare, tenté par l’autrice avec beaucoup de métier (on a déjà dit à maintes reprises sur ce blog que la part de fabrication dans les séries policières grand public est presque inévitable, qu’elle offre un résultat charmant ou non), qui déclenche ici l’intérêt : ne se contentant pas d’être bourru, ou tortueux lorsqu’il s’agit de protéger ses petites faiblesses, à l’image du truculent commissaire sicilien Salvo Montalbano, par exemple, le personnage d’Agatha Raisin est résolument antipathique.
Et c’est ainsi qu’une littérature policière légère (presque trop légère, les intrigues policières n’ayant pas ici un rôle vraiment sérieux, et la plupart des personnages de passage ayant l’épaisseur de leur fonction), en utilisant ce truchement audacieux – et plutôt rare – pour parodier, à soixante-dix-ans de distance, les romans les plus campagnards d’Agatha Christie, bien entendu, nous offre un angle inattendu, et ma foi plutôt intéressant, pour pénétrer l’organisation mouvante d’une certaine société britannique contemporaine, et de ses structures de classe bizarrement évolutives.
x


Jérôme Bonnetto
Jérome Bonnetto est un jeune auteur, né à Nice, on le sent dans ses premiers livres, puis parti vivre à Prague où il enseigne les lettres et le cinéma. Trois petits romans, plutôt de longues nouvelles, puis deux romans chez Inculte Edition, agréables à lire. Deux paires de livres à découvrir.
« La Certitude des Pierres » (2020, Edition Inculte, 189 p.) commence par un Prologue, ce qui est original. « Le vent de Ségurian remonte le chemin Saint-Bernard et va se perdre tout en haut de la montagne, au-delà des forêts. C’est un vent tiède et amer comme sorti de la bouche d’une vieille, un souffle chargé de poussières de cyprès et d’olives séchées qui emporte avec lui les derniers rêves des habitants et les images interdites – les seins de la voisine guettés dans l’entrebâille -ment d’une porte, les rires des hommes à tête de chien, la dame blanche qui hante les bois. Dans sa course, il écarte ses bras et fait bruisser les feuillages des arbustes, les herbes folles, comme une rumeur. Partout sur les chemins, il efface les traces de pas ». Pour un peu, on se croirait dans du Giono, chez Jean de Florette. « On dort. Personne ne sait à qui appartient la nuit. Tout est gris-mauve et les chats ont des yeux de loup ». Puis c’est le retour à la vie quotidienne. « On allume ici une lampe, là une cafetière, on fait glisser une savate, claquer l’élastique d’un slip ». Et tout ce beau décor se termine brutalement. « Chaque jour serait une naissance s’il n’y avait les hommes. Deux coups de chevrotine déchirent l’aube. Voilà, ça va commencer. Pas besoin de faire un dessin ». Mais Jérome Bonnetto en fait un roman de presque 200 pages, modulé sur six Saint Barthélémy (24 Aout) et un Epilogue. Normal, il y avait un Prologue. Autant déflorer tout de suite la fin, c’est-à-dire « l’évènement dramatique qui vient de se produire sur la commune de Ségurian » et sa conclusion « Il y a des miroirs sales à Ségurian dont les enfants hériteront avant de les rendre à leurs propres enfants ».
Reste à lire les six chapitres, heureusement de plus en plus courts. Et suivre l’histoire de Guillaume Levasseur (« 1.90 m, 100 kg »). Un 24 Août. « C’est le 24 août qu’on était devenu homme, frère, amant, et fier surtout ». « C’était comme si le village n’avait qu’un jour à son calendrier ».
Il revient donc au village après avoir bourlingué dans le vaste monde, avoir « travaillé en Afrique pour une ONG » et voulait monter une bergerie. Fin de la première Saint Barthélémy
Un an plus tard, on est de retour chez Jean de Florette, ou à la bergerie. « Une cinquantaine de moutons et de brebis, plus quelques chèvres ». Le quotidien. Sauf que « Bouder la Saint Barthélémy, ça ne se fait pas ». les relatons ne s’arrangent pas entre le berger et les chasseurs, ni entre leurs chiens et les moutons. Chiens ou loups ? « Il y avait un compte rond et les loups ne savent pas compter ». Tout le village est maintenant partagé entre les deux clans. Et au milieu « Le chœur des villageois est là pour commenter l’action sur scène, tandis que le sentiment de fatalité grandit jusqu’à devenir omniprésent ». Entre temps il y a eu Jeanne, qui entre dans la vie du berger « Jeanne sentait bon la tarte aux myrtilles et aimait s’attacher les cheveux avec une vieille barrette en nacre. Elle aimait écouter Bob Dylan et Téléphone à fond dans sa voiture pourrie qu’elle garait partout de manière acrobatique. Elle aimait noter des petites phrases qu’elle oubliait dans des carnets qu’elle égarait. Elle avait vu tous les films de Truffaut, connaissait par cœur toutes les répliques de Jules et Jim ». On pourrait s’en douter, ce n’est pas la culture des Anfosso, dont Emmanuel, le petit dernier, découvre la moto du berger, puis la fête au village et Cindy. Parcours initiatique pour lui aussi, partagé entre ses deux modèles.
Arrive la sixième Saint Barthélémy, et la fin du roman, parsemé de petits morceaux de textes piqués à droite et gauche comme « dessine-moi un mouton » ou « le chasseur sonne toujours deux fois », petits clins d’œil en passant.
Un thème récurrent du retour au village et des habitudes qui s’y sont installées, comme des rites. Un peu comme ces rappels à l’Algérie Française que l’on retrouve par ci, par là. Jean de Florette chez Panurge.
« Le Silence des Carpes » (2021, Edition Inculte, 236 p.). Est-ce une bizarrerie de l’éditeur ou une figure de style, mais mon exemplaire, dûment estampillé des Editions Inculte, se lit de gauche à droite, mais en tournant les pages en sens inverse. Question éditoriale : la version numérique Kindle est-elle formatée de même ? Cela se termine donc par l’incipit, de Christophe Colomb « On ne va jamais aussi loin / que lorsqu’on ne sait pas / où l’on va ». J’ignorais que Pierre Dac ait fait partie de l’équipage de la Pinta ou de la Niña. Mais on apprend à tout âge.
Tout comme dans « La Certitude des Pierres », il y a un Prologue (et un Epilogue). Mais ils encadrent cinq parties divisées en 35 chapitres, dont le dernier est intitulé « Le silence des Carpes ». Entre temps, il y a « Le Capitaine Kurtz », une « Pause Publicitaire » et deux « Interlude »
Ota et Pavel vont à la pêche aux carpes. Des carpes-amours, des carpes sans barbillons à l’intestin long comme chez tous les poissons herbivores. De quoi, une fois séchés, en faire des cordes de violoncelle. Et la mare qu’ils découvrent « grouillait comme une casserole qui attend un demi-kilo de pâtes ». Ou sous une forme encore plus imagée « La surface de l’eau frémissait littéralement, comme la peau d’un vieux à la fenêtre d’une voiture lancée sur l’autoroute ».
La suite est du même flacon « On a vite fait de se noyer dans un verre d’eau ». Sauf que cela se passe à Paris, dans un appartement où vit Paul Solvay, le narrateur. Le robinet fuit, sa femme Pauline le fuit du même coup. Et il n’y a qu’un plombier tchèque qui puisse réparer, surtout le robinet. Et Mirek Ryba s’y connait en robinet, surtout qu’il est originaire de Blednice, au cœur de la Moravie. Il perd cependant une photo, de sa mère, dit-il, dont Paul tombe follement amoureux. Il part illico pour Blednice à la recherche de la personne de la photo. Il se trouve que « ryba » signifie poisson en tchèque, comme en russe d’ailleurs. C’est bien un livre dans lequel on apprend une langue. Y compris à dire « au revoir » (Na shle).
Blednice, sa mare retirée dans la forêt, où les carpes se taisent. Ota et Pavel auraient bien voulu en attraper une ou deux. Les brasseries du centre-ville avec leurs habitués, et les alternances de bière, slivovitz, ou autres boissons fermentées. De temps à autre une digression sur une coutume locale ou un retour dur le cinéma ou la littérature tchèque. Par ci, par-là, également une phrase presque poétique. « L’automne effeuillait négligemment les arbres comme une vieille bourgeoise lassée de tout ». Ou alors du ton du reste du roman. « Tout aussi à l’aise qu’un alexandrin de treize syllabes au milieu d’une tragédie de Racine ».
A défaut d’être un lexique de tchèque, on aurait pu espérer apprendre le langage des capres, fût-ce en tchèque. Elles resteront muettes. « J’ai regardé longuement mon poisson dessiner un monde de trajectoires mystérieuses ».
« Vienne le Ciel » (2007, L’Armourier, 93 p.) second petit roman de l’auteur. Sa maison d’édition, c’est le nom du murier en catalan, et c’est aussi le nom du quartier où est située la maison, à Coaraze, à une vingtaine de kilomètres au nord de Nice. Je l’ai lu, non pas dans l’ordre de parution, mais après « Le Dégénéré ». Surtout après avoir apprécié la poésie de certaines phrases.
Il y a bien quelques-unes de ces phrases, ici ou là. « Les cloches se chamaillent dans toute la ville » ou encore, à propos d’Ada « Elle porte une jupette blanche rayée de bleu, qui se joue dans la descente, se gonflant et se dégonflant comme les méduses réjouies des mers du sud ». Ou encore « Elle caresse les formes du bout de ses doigts de pluie » et se jette dans la Néva, espérant « se perdre dans les flocons phosphorescents de l’eau ». Mais, c’est bien rare.
Pour le reste c’est l’histoire d’un photographe, Alexandre et de Ada Krocinova, jeune tchèque, dans un périple qui va de Prague à Paris, ou Tokyo et Saint Pétersbourg. Mais de ces villes, Ada « ne connaît qu’un hôtel, qu’une chambre ». Lui, est un photographe passionné « Il observait leur visage ébloui par la lumière blanche et la peur de l’objectif puis il appuyait sur le déclencheur souple ».
« Le Dégénéré » (2010, L’Armourier, 128 p.) est le troisième petit roman publié chez L’Armourier, maison d’édition Ce livre, c’est « l’histoire d’un homme qui raconte son histoire, et cet homme, ce n’est pas moi. Merci ! » ainsi commence le livre, avant cet incipit de Franz Kafka « L’Allemagne a déclaré la guerre à la Russie. Après-midi piscine ». L’avant-propos continue, en situant l’histoire à Nice. « Une belle ville. […] Et ailleurs les fleuves coulent au nord ». Voilà pour la géographie. Pour les lecteurs, l’auteur prévient qu’il « n’écrit pas spécialement pour les Niçois, pas plus que pour les unijambistes ou les joueurs de fléchettes gauchers ». Ce n’est donc pas de la littérature de genre, du moins de genre particulier. La suite se déroule sur 44 chapitres courts, de 1 à 5 pages chacun, qui narrent les évènements qui suivent la mort de Victor, une jeune pianiste et Luna. Luna « faisait des trucs à la manière des génies quand on fait trois vœux ». Le reste de sa famille ? « Puis mon père s’éclipsa définitivement et ma mère se défenestra ». Voilà qui règle de façon certaine une description de la vie familiale. Un peu plus loin, il insiste. Nice est une ville où l’on se défenestre à tour de bras. C’est l’autre point de vue du récit. Raconter sa ville. Sa place d’Alsace lorraine et sa stèle à la mémoire de la guerre d’Algérie, y compris la stèle du lieutenant Roger Degueldre, le fondateur des commandos Delta à Alger, qui finit fusillé au fort d’Ivry en 1962. Il faut reconnaitre que le narrateur habite un logement donnant sur cette place, pas très loin de la Promenade des Anglais. Nice ville des abjects, qui élisent des encore plus abjects. Heureusement, si l’on peut dire, il y a la Villa Paradiso, qui abrite le conservatoire de musique
Publié par jlv.livres | 16 janvier 2021, 11:16